Alphonse Daudet
Écrivain des écoliers ?… mais pas que !
Daudet et la Provence
En 1840 naquit le petit Alphonse, à Nîmes.
C’est vers trois ans qu’il arrive à Bezouce, petit village
entre Nîmes et le Pont du Gard. Il est placé dans la famille
TRINQUIER dont la mère est choisie pour élever le jeune Daudet de santé
délicate. Il y est élevé avec les enfants du village et de la famille, dont une
fille de douze ans, qu'il appellera plus tard, dans un roman, « La Trinquierette »…
Il n’oubliera jamais cette période durant laquelle il découvrit et apprit le parler provençal. :
« Ces impressions d'enfance ne
s'oublient jamais.... Comme MISTRAL dans son village, à BEZOUCE, j'ai communié
avec le peuple, j'ai vécu de sa vie, de ses jeux, de ses chansons et de ses
légendes. Si je n'ai pas partagé ses pénibles labeurs, je l'ai vu courbé sur la
glèbe, dans ses lassitudes heureuses, sous les brûlures du soleil, aux
moissons, aux vendanges. Le soir dans le calme des vespres, je l'ai vu...
écouté conter ses travaux, et, sur le banc de pierre devant la porte de la
maison de BEZOUCE, près de lui, je me suis grisé du moût divin de notre
langue ».
En 1849, la famille s’installe à Lyon où
Alphonse entre au lycée Ampère jusqu’en 1859, date à laquelle son père est
ruiné et Alphonse doit renoncer à passer son baccalauréat. Depuis son entrée au lycée, il traîne sa condition modeste
comme un fardeau. Il doit essuyer brimades et humiliations : " Eh, vous le petit chose...",
il transcrira ce traumatisme dans son roman autobiographique en prenant
cette expression comme titre, Le Petit
Chose (1868). Dès lors, il monte à Paris où vit son frère. Durant cette vie
de bohème, il publie Les Amoureuses,
un recueil de poèmes et, en 1859, il fait une rencontre décisive, celle de
Frédéric Mistral qui vient de publier avec succès Mireille. En Provence, il parcourt les paysages de son enfance
oubliée avec lui, ce grand poète occitan de l'époque, fondateur du félibrige (association qui œuvre dans
un but de sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture et de tout ce
qui constitue l'identité des pays de langue d'oc). Un fort lien les unira, à travers une
correspondance fournie, jusqu’à la mort de Daudet en 1897 (1). Mistral introduit
Daudet dans les salons littéraires, ce dernier est ainsi amené à collaborer
avec Paris-Journal, l’Universel et le Figaro, parallèlement, il publie Le Roman du Chaperon Rouge en 1862. Il fréquente aussi le milieu
littéraire et politique, de Gambetta ou Vallès, à gauche, jusqu'à Barbey
d'Aurevilly en passant par Rochefort, le polémiste le plus redouté de son
temps. En 1861, il devient le secrétaire du duc
de Morny demi-frère de Napoléon III et président du Corps Législatif, il le
restera jusqu’à la mort de ce dernier en 1865.
En 1862, poitrinaire, il part pour quelques
temps en Algérie. A son retour en France, de nouveau malade, il s'installe dans
le Midi et retrouve des amis avec lesquels il participe au mouvement de
renouveau de la langue d'Oc. Sous
l’influence de Mistral, il rassemble des notes, impressions et chroniques sur
la Provence durant ses vacances près d’Arles, en 1864, où il achètera la même
année un moulin. Il obtint alors, par le directeur du
journal L’Événement, l’autorisation
de les publier comme feuilleton pendant tout l’été de l’année 1866, sous le titre
de Chroniques provençales. Ce seront plus tard Les Lettres de mon Moulin (1869). Elles lui apporteront la
notoriété.
En 1870, pendant la
Commune, il est incorporé dans la Garde nationale, mais refusant de prendre
parti, il se retire à Champrosay. Pendant la guerre, Alphonse Daudet sert au fort de Montrouge. Il reçoit la
Légion d'honneur. En 1896, Edmond
Goncourt chargea Alphonse Daudet de fonder un groupe littéraire décernant
chaque année un prix à un ouvrage écrit en prose. La première académie ne se
réunira que le 21 décembre 1903 et attribuera le Goncourt à John-Antoine Nau pour "La force ennemie". En
1897, Daudet affiche sa position antidreyfusarde…
Depuis la mort du duc de Morny, Alphonse
Daudet ne se consacre plus qu’à l’écriture, de chroniqueur, il devient aussi
romancier des mœurs contemporaines à travers ses romans « réalistes »
dans lesquels il dépeint la société qui l’entoure : les malchanceux (Jack, 1876), les puissants (Le Nabab, 1877), les déchus (Les Rois en Exil, 1879), les politiciens
(Numa Roumestan, 1881). Il va aussi
dénoncer les méfaits du fanatisme religieux (L’Evangéliste, 1883), décrire les coulisses de l’Académie (L’immortel, 1890). Son succès lui vaudra
alors des amitiés connues : Flaubert, Tourgueniev, Goncourt, Zola, Hugo,
Renoir, Manet… Bientôt, Daudet subit les premières
atteintes d’une maladie incurable de la moelle épinière : le tabes
dorsalis, dû a-t-on dit à l’époque, à
la syphilis contractée dans ses jeunes années. Il continuera de publier
jusqu’en 1895 et décédera le 16 décembre
1897 à Paris loin de sa Provence, à l’âge de 57 ans. Il est enterré au
cimetière du Père Lachaise, en pleine affaire Dreyfus et malgré les opinions
qui les opposaient, Emile Zola prononce un discours ému aux obsèques de son ami
à qui il consacrera plusieurs articles élogieux.
L’Alphonse Daudet romancier et dramaturge
écrivit dix-sept pièces mais poursuivit cependant son travail de conteur : il
publia en 1872 Tartarin de Tarascon (au
tout début « Barbarin »), qui fut son personnage mythique, les Contes du lundi en 1873, un
recueil de contes sur la guerre franco-prussienne
Certains de ses récits, notamment dans Les Lettres de mon moulin,
sont restés parmi les histoires les plus populaires de notre littérature
enfantine, comme La Chèvre de
monsieur Seguin, Les Trois
Messes basses ou L’Élixir du
Révérend Père Gaucher (3).
«...Où les grands hommes ont habité,
quelque chose d'eux-mêmes erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges »,
extrait de Tartarin de Tarascon.
LES TROIS MESSES
BASSES
Pour voir la vidéo,
cliquez sur ce lien :
LA CHEVRE DE MONSIEUR
SEGUIN
Pour écouter le conte,
cliquez sur ce lien :
(1) :
Correspondance Alphonse Daudet - Frédéric
Mistral 1860 – 1897
Lire la correspondance : https://www.cieldoc.com/libre/integral/libr0579.pdf
(2) : Les Contes du lundi sont également
plus engagés et sont imprégnés de l’Algérie et des colonies africaines. Dans Monologue
à bord, la déportation des communards (et plus tard des déportés kabyles) en Nouvelle-Calédonie
y est évoquée. Dans Le Caravansérail, on découvre l’immigration alsacienne en
Algérie. Le Caravansérail, auberge
tenue par une Alsacienne, « à cent lieues d’Alger », fut le repos des
soldats de la conquête avant que ces derniers ne se retrouvent à la bataille de
Wissembourg (première bataille de la guerre de 1870) et qu’il ne soit
incendié par les Arabes révoltés.
Dans Un décoré du 15 août, un agha du Chélif monte
à Paris tenter d’obtenir la Légion d’honneur que le bureau arabe lui a promis.
À Paris encore, Kadour, Le Turco
de la Commune, meurt sur les barricades de la Commune et sous les balles
Versaillaises qu’il croyait « Brussiennes ». Dans Le mauvais zouave, le père du
déserteur part à Sidi Bel Abbès consacrer à la France les cinq ans
dus par son fils.
Contraste
dans Tartarin de Tarascon,
Alphonse Daudet relate les sites algériens comme de banals paysages de France (« au
lieu du caravansérail que j'imaginais, je trouvai une ancienne auberge de
l’Île-de-France »). Nogent, avec la diversité des soldats, zouaves,
artilleurs, apparaît à Daudet comme « une petite ville d’Algérie. » et
il décrit ainsi la Fouilleuse, une ferme au pied du mont Valérien, « ce
grand paysage mélancolique […] a quelque chose des plaines du Chélif ou de
la Mitidja ».
Les
contes du lundi :
Première partie : La Fantaisie et l'Histoire
La Dernière Classe
La Partie de billard
La Vision du juge de Colmar
L'Enfant espion
Les Mères
Le Siège de Berlin
Le Mauvais Zouave
Le Pendule de Bougival
La Défense de Tarascon
Le Prussien de Bélisaire
Les Paysans à Paris
Aux avant-postes
Paysages d'insurrection
Le Bac
Le Porte-drapeau
La Mort de Chauvin
Alsace! Alsace!
Le Caravansérail
Un décoré du 15 août
Mon képi
Le Turco de la Commune
Le Concert de la huitième
La Bataille du Père-Lachaise
Les Petits Pâtés
Monologue à bord
Les Fées de France
Deuxième partie : Tableaux parisiens
Un teneur de livres
Avec trois cent mille francs que m'a promis
Girardin
Arthur
Les Trois Sommations
Un soir de première
La Soupe au fromage
Le Dernier Livre
Maison à vendre
Contes de Noël : Un réveillon dans le
marais
Contes de Noël : Les
Trois Messes basses
Troisième partie : Caprices et Souvenirs
Le Pape est mort
Paysages gastronomiques
La Moisson au bord de la mer
Les Émotions d'un perdreau rouge
Le Miroir
L'Empereur aveugle
LA
DERNIERE CLASSE
Ecouter le conte : https://www.youtube.com/watch?v=3Tpe_PbRiTc
Texte intégral :
« Ce matin-là j'étais très en
retard pour aller à l'école, et j'avais grand peur d'être grondé, d'autant que
M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur les participes, et je n'en
savais pas le premier mot. Un moment l'idée me vint de manquer la classe et de
prendre ma course à travers champs.
Le temps était si chaud, si clair. On
entendait les merles siffler à la lisière du bois, et dans le pré Rippert
derrière la scierie, les Prussiens faisaient l'exercice. Tout cela me tentait
bien plus que la règle des participes; mais j'eus la force de résister, et je
courus bien vite vers l'école.
En passant devant la mairie, je vis qu'il y
avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches. C''est de là que
nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les
réquisitions, les ordres de kommandantur.
Et je pensai sans m'arrêter: « Qu'est-ce
qu'il y a encore ? ». Alors, comme je traversais la place en courant, le
forgeron Wachter, qui était là avec son apprenti en train de lire l'affiche, me
cria :
« Ne te dépêche pas tant, petit; tu y arriveras toujours assez tôt à ton école ! ». Je crus qu'il se moquait de moi, et j'entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue, les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables :
« Un peu de silence ! »
« Ne te dépêche pas tant, petit; tu y arriveras toujours assez tôt à ton école ! ». Je crus qu'il se moquait de moi, et j'entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue, les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables :
« Un peu de silence ! »
Je comptais sur tout ce train pour gagner mon
banc sans être vu; mais justement ce jour-là tout était tranquille, comme un
matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés
à leurs places, et M. Hamel, qui passait et repassait avec la terrible règle en
fer sous le bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand
calme. Vous pensez, si j'étais rouge et si j'avais peur ! Eh bien, non. M.
Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement : « Va vite à ta place,
mon petit Frantz; nous allions commencer sans toi ».
J'enjambai le banc et je m'assis tout de
suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai
que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la
calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de
distribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose
d'extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir
au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du
village assis et silencieux comme nous, le vieux Hauser avec son tricorne,
l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tout ce
monde-là paraissait triste; et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé
aux bords qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes
posées en travers des pages.
Pendant que je m'étonnais de tout cela, M.
Hamel était monté dans sa chaire, et de la même voix douce et grave dont il
m'avait reçu, il nous dit : « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous
fais la classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand
dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine... Le nouveau maître arrive
demain. Aujourd'hui c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être
bien attentifs.»
Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah !
Les misérables, voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. Ma dernière leçon
de français !...
Et moi qui savais à peine écrire! Je
n'apprendrais donc jamais ! Il faudrait donc en rester là !... Comme je m'en
voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à
faire des glissades sur la Saar ! Mes livres que tout à l'heure encore je
trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte me
semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter.
C'est comme M. Hamel. L'idée qu'il allait partir, que je ne le verrais plus me
faisait oublier les punitions et les coups de règle. Pauvre homme !
C'est en l'honneur de cette dernière classe
qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche, et maintenant je comprenais
pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela
semblait dire qu'ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent, à cette
école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de ses quarante
ans de bons services, et de rendre leurs devoirs à la patrie qui s'en allait...
J'en étais là de mes réflexions, quand
j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas
donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien
haut, bien clair, sans une faute; mais je m'embrouillai aux premiers mots, et
je restai debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la
tête. J'entendais M. Hamel qui me parlait : «Je ne te gronderai pas, mon petit
Frantz, tu dois être assez puni... voilà ce que c'est. Tous les jours on se
dit: Bah ! J’ai bien le temps. J'apprendrai demain. Et puis tu vois ce qui
arrive... Ah! Ç’a été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son
instruction à demain. Maintenant ces gens-là sont en droit de nous dire: Comment
! Vous prétendiez être Français, et vous ne savez ni parler ni écrire votre
langue !... Dans tout ça, mon pauvre Frantz, ce n'est pas encore toi le plus
coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire.
« Vos parents n'ont pas assez tenu à vous
voir instruits. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux
filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même n'ai-je rien à me
reprocher ? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au
lieu de travailler ? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que
je me gênais pour vous donner congé ?... »
Alors d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit
à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue
du monde, la plus claire, la plus solide: qu'il fallait la garder entre nous et
ne jamais l'oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient
sa langue, c'est comme s'il tenait la clef de sa prison... Puis il prit une
grammaire et nous lut notre leçon. J'étais étonné de voir comme je comprenais.
Tout ce qu'il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n'avais
jamais si bien écouté, et que lui non plus n'avait jamais mis autant de
patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller le pauvre homme
voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d'un
seul coup.
La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour
ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels
était écrit en belle ronde: France,
Alsace, France, Alsace. Cela faisait comme des petits drapeaux qui
flottaient tout autour de la classe pendus à la tringle de nos pupitres. Il
fallait voir comme chacun s'appliquait, et quel silence! On n'entendait rien
que le grincement des plumes sur le papier. Un moment des hannetons entrèrent;
mais personne n'y fit attention, pas même les tout petits qui s'appliquaient à
tracer leurs bâtons, avec un cœur, une conscience, comme si cela encore était
du français... Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient bas, et je
me disais en les écoutant : « Est-ce qu'on ne va pas les obliger à
chanter en allemand, eux aussi ? »
De temps en temps, quand je levais les yeux
de dessus ma page, je voyais M. Hamel immobile dans sa chaire et fixant les
objets autour de lui comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute sa
petite maison d'école... Pensez ! Depuis quarante ans, il était là à la même
place, avec sa cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement les
bancs, les pupitres s'étaient polis, frottés par l'usage; les noyers de la cour
avaient grandi, et le houblon qu'il avait planté lui-même enguirlandait
maintenant les fenêtres jusqu'au toit. Quel crève-cœur ça devait être pour ce
pauvre homme de quitter toutes ces choses, et d'entendre sa sœur qui allait,
venait, dans la chambre au-dessus, en train de fermer leurs malles! Car ils
devaient partir le lendemain, s'en aller du pays pour toujours.
Tout de même il eut le courage de nous faire
la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire;
ensuite les petits chantèrent tous ensemble le BA BE BI BO BU. Là-bas au fond
de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lunettes, et, tenant son abécédaire
à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu'il s'appliquait lui
aussi; sa voix tremblait d'émotion, et c'était si drôle de l'entendre, que nous
avions tous envie de rire et de pleurer. Ah ! je m'en souviendrai de cette dernière
classe...
Tout à coup l'horloge de l'église sonna midi,
puis l'Angelus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de
l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres... M. Hamel se leva, tout pâle, dans sa
chaire. Jamais il ne m'avait paru si grand.
« Mes amis, dit-il, mes amis, je... je... »
Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait
pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de
craie, et, en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put :
« VIVE LA FRANCE ! »
Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et,
sans parler, avec sa main il nous faisait signe :
« C'est fini... allez-vous-en. »
« C'est fini... allez-vous-en. »
(3) : « Esthétiquement,
pourtant, les Lettres de mon moulin, trop
rarement lues in extenso, sont loin d'être un pur répertoire des beautés du
soleil. Un fond de mélancolie habite plusieurs récits, « les Vieux »,
« les Douaniers », « la Mort du Dauphin » et
l'extraordinaire « Légende de l'homme à la cervelle d'or ».
Concurremment au Daudet poète, il y a un Daudet réaliste, et même naturaliste,
dans la droite ligne des écrivains de son temps, Zola ou les Goncourt.
Le mariage de Daudet avec la comédienne Julia Allard, en 1867, est suivi,
cette même année, de la naissance de Léon, premier fils d'Alphonse (il en aura
un second, Lucien, en 1878). L'enfant rencontre chez ses parents tout ce que la
France compte de grands noms des lettres, et s'engage, parallèlement à ses études
de médecine, dans une carrière littéraire qui le conduira de la gauche
anarchisante (Les Morticoles, en 1898, sont
l'une des satires les plus violentes jamais écrites du milieu médical) à la
droite la plus extrême, antidreyfusarde, antisémite, attaquant au fil des
colonnes de l'Action française (qu'il
fonde avec Maurras en 1908), les politiciens libéraux, comme Briand. On lui
doit un joli livre sur son père, rédigé en 1898 – il lui a succédé à
l'académie Goncourt en 1897. En fait, il y a une logique souterraine du
provincialisme d'Alphonse au nationalisme de Léon, logique qui éclatera au
grand jour sous Pétain, quand les valeurs régionales seront mises au pinacle,
que Giono, avec le Chant du monde,
Pagnol, avec la Fille du
puisatier, marcheront sur les traces de Daudet, et que les textes des Lettres de mon moulin seront
la base des dictées inlassablement ânonnées dans les écoles.
Alphonse exploite au mieux la fibre du
dépaysement. Libre à présent de tout souci pécuniaire, il publie les Aventures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon (1872) et les Contes
du lundi (1873). Peut-être sent-il, à certaines réticences, qu'il a
trop versé dans le folklore provençal. Il renverse la barre et donne,
avec Robert Helmont (1873), Fromont jeune et Ristler aîné (1874),
et surtout Jack (1876), Le Nabab (1878) ou Les Rois en exil (1879), les
grands romans réalistes conformes au goût des lecteurs de la Troisième République.
Jack, en particulier,
histoire d'un enfant pauvre, délaissé par sa mère, ouvrier courageux mais sombrant
peu à peu dans l'amertume et l'alcool avant de mourir phtisique, accumule tous
les poncifs de la littérature populiste des Dickens et Zola que plus tard, Léon
Daudet critiquera si violemment.
Daudet en arrive même à dénoncer le côté
hâbleur des Méridionaux dans Numa
Roumestan (1881), portrait au vitriol d'un politicien qui ressemble
beaucoup à Gambetta. Daudet n'est pas dupe de sa propre verve méridionale, et
le conteur inlassable sait faire son autocritique : « Nous ne sommes
que des gens d'imagination et de paroles débordantes, des trouveurs, des
brodeurs, des improvisateurs féconds, ivres de sève et de lumière, qui se
laissent prendre eux-mêmes à leurs inventions stupéfiantes et ingénues. ».
Le succès, sans cesse grandissant, du
réaliste Daudet assure, par effet de retour, le succès, d'abord relatif, du
poète Daudet : relayées par le zèle des « hussards noirs de la
République », les instituteurs, qui l'instillent dictée après dictée dans
la conscience de leurs élèves, les Lettres
de mon moulin s'imposent dans le public, et les autres écrits
« pittoresques » de Daudet sont pareillement plébiscités. Tartarin
revient dans Tartarin sur les
Alpes (1885) et Port-Tarascon (1890).
Alternance toujours : Daudet écrit L'Évangéliste (1883), étude
sur les ravages du zèle religieux, Sapho (1884),
histoire quasi autobiographique d'une liaison entre un jeune homme et une
actrice vieillissante, et L'Immortel (1888),
satire acide des mœurs littéraires et académiques parisiennes. Il revient une
dernière fois à la Provence, mais une Provence de la nuit et des fantasmes, une
Camargue des brumes et des amours enfuies, avec Le
Trésor d'Artalan (1897). Entre-temps, il a rédigé ses Souvenirs d'un homme de lettres et Trente Ans de Paris (1888),
série de croquis particulièrement parlants du milieu littéraire parisien.
Depuis 1884, Daudet se sait atteint d'une
maladie nerveuse incurable – en fait, les ravages d'une syphilis
contractée dans sa jeunesse conjuguée à sa tuberculose. Sa moelle épinière est
touchée, et le mal lui fait connaître des affres épouvantables. Il en tirera un
chef-d'œuvre posthume, La
Doulou (« la Douleur »), publié en 1931, dans lequel il
décrit l'angoisse, les déchirements, les traitements imbéciles d'une maladie
incurable, et les impératifs de ses devoirs de père : « Je ne sais
qu'une chose, crier à mes enfants : “ Vive la vie ! ”
Déchiré de maux comme je suis, c'est dur. »
Jusqu'à sa mort, en 1897, Daudet oscille
ainsi de la franche gaieté (Tartarin renouvelant Matamore, Risler aîné en
rajoutant sur le Nucingen de Balzac, et le
Nabab sur le Bourgeois
gentilhomme) à l'ironie cinglante
(Numa Roumestan), et même à la mélancolie la plus morbide (le Nabab
meurt d'apoplexie, Jack expire à l'hôpital, Ristler se pend et le Petit Chose
ne sera jamais poète, mais quincaillier). Comme dit l'un des personnages des
« Douaniers » : « Voyez-vous, monsieur… on a quelquefois
bien du tourment dans notre métier. »
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Alphonse_Daudet/115749
P.P







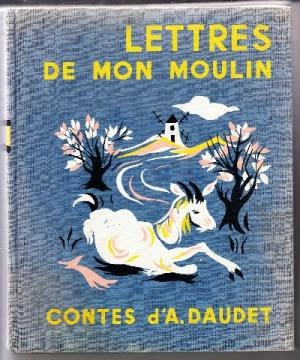

















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire