C’était mieux avant…
Mythe ou réalité ?
Là
est la constante de l’avant, du présent et du futur
Nous avons tous une kyrielle
d'instituteurs et d'institutrices dans le cœur. Tous ceux qui ont impressionné
(au sens quasi photographique) notre jeune cervelle de moineau. Ce souvenir-là
réunit le meilleur et le pire : on a adoré Mme. X ou M. Y, on a détesté M. V ou
Mlle P. Comme Claudine à l'école a aimé et détesté tout à la fois la fameuse
Mlle Sergent. Que sait-on d'eux et d'elles ? Rien. Ils et elles sont passés
dans nos existences comme des images d'autorité, de devoirs, de leçons, de
récréations, de réussites ou d'échecs. Et pour les plus de 50 ans, ils et elles
s'associent à des encriers, des tableaux noirs, des craies ou des cartes
murales. À nos enfants et petits-enfants, d'autres images resteront, depuis le
poisson rouge de la classe jusqu'au premier stylo, la première tablette ou le
tableau numérique et sa floraison d'images. Mais le maître et la maîtresse de
la maternelle, promus profs au CE1 ou au CM2, seront toujours ces premiers
repères adultes hors parents dont on ignore tout, au fond. Qui les a inventés,
puisque ce n'est pas Charlemagne ? Comment apprenait-on avant Jules Ferry et sa
grande réforme ? Et ces instituteurs de la « communale », comment étaient-ils
formés ? Pourquoi les a-t-on appelés des « hussards noirs » ? Aujourd'hui, ces
« professeurs des écoles » choisissent-ils toujours ce métier par vocation,
passion, ont-ils toujours l'envie d'être le maître ou la maîtresse ? Nous avons
tout appris à l'école, le monde, les autres, la vie. Auprès de ces passeurs
dont nous fûmes un jour la joie, l'espoir ou l'inquiétude. Et qui, tous, nous
ont aimés, malgré tout. Parce que leur métier l'exige (1).
De
l’encre violette et une plume qui glisse sur un cahier d’écriture, une craie
carrée qui déroule les pleins et les déliés au tableau noir, un maître
impitoyable qui toise une troupe aux bras croisés, des bons points et des
mauvais, de la morale et des dictées, des photographies de classes aux enfants
endimanchés et aux fiers instituteurs de la République … et voilà la nostalgie
à la rescousse de la « baisse de niveau » et du « manque de
discipline », le retour de l’indécrottable vieille école et de ses
clichés…
C’était
le temps où les écoliers savaient lire, compter, réciter la liste des
départements et des chefs-lieux de canton, se tenir en rang serrés. Le temps
aussi où les maîtres inspectaient impitoyablement les ongles et les cheveux. En
somme, de quoi faire verser une petite larme à nos anciens qui visitent le
musée.
Méfiance
tout de même, Claude Lelièvre, historien de l’éducation nous met en
garde : «C’est un classique qui revient régulièrement. Quand on n’a pas
d’utopie porteuse, on se réfère à un passé mythique. Comme en ce moment, faute de
cap. On a beau parler de refondation de l’école, l’idée ne passe pas dans le
grand public et chez une partie des enseignants. Et comme, dans le même temps,
la France n’est pas très bien placée dans les classements, notamment dans la
lutte contre les inégalités. On en revient à nos mythes, telle l’école de la
IIIe République, qui, dans nos esprits, englobe aussi
la IVe République». C’était mieux avant ? Peut-être… ou pas. Petites remarques comparatives :
De mon temps, on ne faisait
pas de fautes ! Admettons mais la seule certitude, c’est que les bambins d’aujourd’hui
passent quasiment moitié moins de temps à faire du français que les écoliers de
la Troisième République. Les nécessaires évolutions pédagogiques et notamment
l’allongement des vacances, la suppression des cours du samedi ou encore la
multiplication des matières ont pesé lourdement sur l’apprentissage de
l’orthographe usuel dont chacun sait qu’il requiert de longues heures
répétitives. Ce fut un choix assumé qui souleva de tout temps la polémique
comme le souligne Christian Signol : «La question de l’orthographe est
une sorte de totem français. Une obsession qui n’existe que chez nous. Et déjà
au début du XXe siècle, on se plaignait d’une crise de
l’orthographe. C’est récurrent. C’est encore revenu à l’entre-deux-guerres. A
cette époque, on accusait la méthode de lecture globale non pas de ruiner la
lecture, comme ce fut le cas dans les années 70-80, mais l’orthographe.»
Oui mais de mon temps, on savait écrire ! Admettons une nouvelle fois, on peut s’extasier devant
les belles pages d’écriture mais notons au passage que, souvent, seuls les cahiers des
bons élèves sont parvenus jusqu’à nous : « le débat a fait rage, à la
fin du XIXe siècle, entre les tenants de l’écriture droite et
ceux de l’école penchée : c’est la première qui a été retenue comme mieux à
même d’éviter mauvaises postures et scolioses ». La chose était d’importance mais qu’en fut-il des fautes ? Il est
de notoriété publique que les élèves ont perdu la maîtrise de l’orthographe
principalement avec l’autorisation du stylo-bille dans les écoles en
1965 !
Oui mais de mon temps, le « niveau » était
plus élevé ! Admettons toujours,
nous voilà repartis sur le sacro-saint « moi
j’ai eu mon certif ». Mais comme le note Claude Lelièvre : « Mais
de quel niveau parle-t-on ? Quelles générations compare-t-on précisément ? Sur
quelles matières ? ». Du reste,
jusque dans les années 30, un petit pourcentage des élèves étaient présentés au
Certificat d’Etude et Olivier Magnan de rajouter : « Dans les faits,
seule une minorité décrochait le fameux certif. (..) En 1986, parce qu’on
a mis la main sur 3 000 copies de certificats d’études, de 1873
à 1877 dans la Somme, on décide de faire passer (tous biais corrigés) les
mêmes épreuves à 3 000 élèves dans toute la France.» ET
alors ?
« C’est la fin du XIXe siècle
qui l’emporte ! » Je vous l’avais dit… Mais « Plutôt que de
parler de niveau, on devrait se pencher sur les nouvelles compétences demandées
aux élèves : expression orale, écrite, recherche d’information, informatique,
ouverture sur le monde…» conclut
Magnan.
Oui mais de mon temps, les garçons n’étaient pas avec
les filles ! C’est vrai, mais la mixité a-t-elle vraiment
changé les choses ? Pas sûr quand
on observe que les filles réussissent toujours mieux que les garçons dès
l’école primaire, mais qu’à l’arrivée, un diplômé d’école d’ingénieurs sur
trois seulement est une femme. Selon Olivier
Magnan : « on revient de loin. Si le mot mixité est entré dans
le dictionnaire en 1842, les textes officiels de l’Education nationale ne
l’utiliseront qu’à compter de 1957 !». «L’école républicaine ne pouvait
pas lutter contre tout, ajoute
Claude Lelièvre. Elle a lâché sur la mixité face à l’Eglise, qui redoutait
des comportements sexuels débridés. Finalement, la mixité a commencé à
s’instaurer au début des années 60, donc avant 1968. Derrière cela,
il y avait l’idée que les filles soient moins godiches et les garçons moins
violents.» De nos jours, la mixité
est bien installée et rentre en lutte contre les stéréotypes, même si de bonnes
âmes crient toujours à la confusion des sexes, à l’image de Jean Dutourd qui
déclarait en son temps : «Que croyaient-ils qu’il sortirait de la
mixité sinon une grande valse des pucelages et la transformation méthodique des
lycées en bordels ?»… Délicat, vous en conviendrez.
Oui mais de mon temps il y avait de la
discipline ! Et même encore plus
avant : dès la fin de l’Antiquité, « l’enseignement
ne s’adresse qu’à quelques enfants frappés et dressés par des maîtres sans
prestige ». De cette tradition « pédoplégique » (la
pédoplégie étant la pédagogie par les coups), le symbole pourrait bien être les
mémoires d’un instituteur du 18ème siècle qui exerçait en
Souabe : « ayant tenu un compte
méticuleux de ses faits et gestes en 51 ans et 7 mois de carrière, il
aboutissait à un total de 911 257 coups de bâton, dont 800 000
environ à cause du latin, et 124 000 coups de verge, dont 76 000
environ à cause des versets de la bible ou des cantiques, plus quelques
milliers de soufflets sur la bouche ou de calottes sur les oreilles, pour des
raisons tout aussi pédagogiques. » (François Jacquet-Roussillon, in Instituteurs avant la République, 1999).
Suivirent les oreilles longuement tirées par le maître, les coups de règle sur
les doigts, le supplicié à genou sur la bûche, le bonnet d’âne… Comment
regretter cette sévérité extrême, même si la tolérance de la gifle ou du tirage d’oreilles avait pourtant la
"compréhension", pendant des décennies, des familles, complices dans
une certaine limite de cette éducation par les coups pourtant interdite depuis
la Révolution, interdiction confirmée par les lois Ferry ? Selon les
travaux du chercheur Bernard Douet, conduits en 1980 sur les punitions
à l’école et malgré bien sûr quelques exceptions ou saute d’humeur impardonnables bien sûr souvent
explicables, « un ou une instit reste un être humain dont la patience
pédagogique connaît des limites, l’immense majorité des sanctions se
réduit à des punitions à faire signer ou à des détours par le couloir.» Enfin
un bon point pour aujourd’hui !
(1) : Note d’après Histoire Vraie des Violences à l’Ecole.
Sources :
- Olivier Magnan, La Vraie Histoire des Instits, 2014
- Claude Lelièvre, Histoire Vraie des Violences à l’Ecole, 2007
- Julie Malaure, lepoint.fr
- Catherine Mallaval, liberation.fr

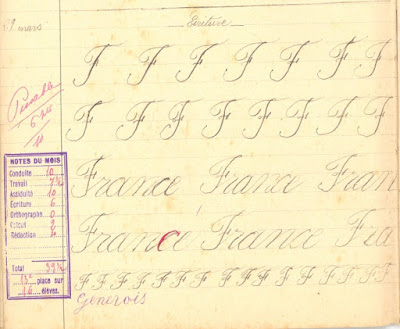
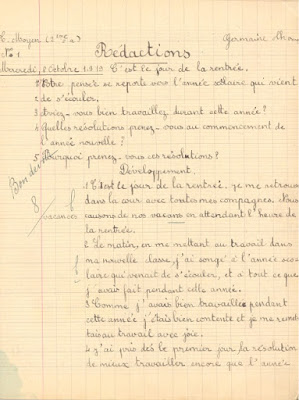










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire