La lettre d’obédience
Littera
Obedientiales
La
lettre d’obédience est une lettre qu'un
supérieur donne à des religieuses ou à des religieux appartenant aux ordres
enseignants, et que le gouvernement reçoit comme équivalent d'un certificat de
capacité, notamment sous la loi Falloux :
Art. 49 −Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet
de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses
vouées à l'enseignement et reconnues par l'État.
Comme le dira Rouland, le 30
mars 1867 : « Les lettres d'obédience sont
évidemment un privilège.... la lettre d'obédience n'est point l'équivalent vrai
du certificat de capacité ; la lettre d'obédience est un acte purement
potestatif, qui appartient en entier au supérieur qui le délivre. » [Rouland devant le sénat (deux
fois ministre de l’Instruction Publique : 1856-57 et 1860-63,
Moniteur, 30 mars 1867, p. 383, 6e col.].
La définition
administrative originelle de la lettre d'obédience était
rédigée ainsi : « Ordre donné à un
congréganiste, par son supérieur, de se rendre dans une commune pour y prendre
la direction de l'école ». Cette fameuse lettre joua un
grand rôle dans l'enseignement primaire en France, de 1819 à 1881. L'article 109 du décret du 17 mars 1808 affilia les Frères
des Ecoles chrétiennes à l'Université impériale. Ce décret stipulait que les
Frères « seraient brevetés et
encouragés par le grand maître » (le grand maître des Universités Fontanes
nommé par Napoléon lui-même en l’occurrence) mais ce que l’article ne précisait
pas, c’est si ce brevet serait individuel ou couvrirait toute une congrégation.
Cette dernière hypothèse fut plébiscitée par le Supérieur général des Frères
comme il l’expliqua plus tard dans une lettre au ministre de l’intérieur Lainé,
le 7 juillet 1818 : « Son Excellence
[le grand maître Fontanes] comprit que le diplôme pour une congrégation devait
être unique, et le donna tel car vouloir obliger chaque frère à un diplôme
particulier, ce serait séparer les membres de leur chef et détruire la
congrégation ». En 1818, les Frères ne reconnaissent plus l’autorité de
l’Université et s’auto dispensent de toute autorisation ou brevet de l’Etat.
Pour apaiser les tensions, le roi n’hésitera pas à remplacer le ministre de
l’intérieur Lainé par Decazes, plus ouvert aux revendications religieuses. Après
maintes péripéties et conflits entre 1816 et 1819, les droits d’enseigner
furent délégués aux autorités religieuses (les frères pouvaient recevoir le
brevet au vu d’une lettre d’obédience délivrée par le Supérieur général qui les
nomme ou les déplace à sa convenance). Cette délégation religieuse ne concerna
pas que les congrégations enseignantes mais aussi les enseignants laïcs privés qui
furent soumis à une autorisation d’enseigner délivrée par l’Eglise à la suite
de l’ordonnance royale du 8 avril 1824 remettant au clergé la responsabilité de
l’enseignement primaire (1).
P.P
Dans le même
esprit, la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juin 1819 avait étendu
l’ordonnance de février 1816 aux écoles de filles tandis que la circulaire du
29 juillet de la même année
permettait aux institutrices congréganistes d’échapper aux brevets de
capacité : «
Vous pourrez, écrit le ministre, leur délivrer l'autorisation d'enseigner, d'après l'exhibition de
leur lettre d'obédience. Ces
institutrices seront ainsi assimilées aux Frères des Ecoles chrétiennes. », ce
que confirma l’ordonnance royale du 1er mai 1822 dans son
article 3 : « le brevet de capacité
serait délivré à chaque frère de l'Instruction chrétienne sur le vu de
la lettre particulière d'obédience qui lui aurait été délivrée par le
supérieur général de la société ».
La loi du 15 mars
1850 transforma en un droit absolu ce qui était resté, sous la Restauration et
la monarchie de Juillet, une tolérance facultative, subordonnée à
l'autorisation du recteur ; elle dit, à l'art. 49 : « Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux
institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à
l'enseignement et reconnues par l'Etat ». En ce qui concerne les
congréganistes hommes, on n'osa pas rétablir leur privilège sous la forme de la
lettre d'obédience ; mais on créa à leur usage le certificat de stage (art.
47) : « le stage, si facile à faire
accomplir par les jeunes gens appartenant aux congrégations religieuses, les
dispense de tout examen et brevet de capacité, » écrivait l'abbé Dupanloup
dans une brochure.
Dès lors, la lettre d’obédience tenait lieu de
brevet de capacité pour les institutrices appartenant à des congrégations
reconnues par l’Etat, comme ce fut le cas dans les écoles de la Mine à Montceau
qui employaient des sœurs de Saint-Vincent de Paul tandis que les frères
maristes des mêmes écoles ne devaient produire qu’un certificat de stage (2).
La généralisation de la lettre
d’obédience est l’œuvre de Falloux, légitimiste et catholique libéral,
député à l’Assemblée constituante de 1848 et ministre de l’Instruction publique
du 20 décembre 1848 au 30 octobre 1849 (3). Il y eut bien, ultérieurement,
des tentatives de suppression de la fameuse lettre, notamment de la part de
quelques membres du Corps législatif dont Jules Simon, Eugène Pelletan et
Léonor Havin, à l’occasion de la discussion de la loi du 10 avril 1867 (4).
Ils présentèrent, en effet, un amendement dans ce sens mais il fut écarté au
motif qu’il aurait eu pour résultat de rendre à peu près impossible le
recrutement massif des institutrices au moment où la loi nouvelle allait doter
le pays de plusieurs milliers d’écoles de filles.
(1) : Après les « Cent
jours », d’août 1815 à novembre 1820, une Commission de
l’Instruction publique, constituée de cinq membres, est formée et présidée par
Royer-Collard en remplacement du grand maître de l’Université impériale. Elle est
placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et relayée sur le terrain,
par les inspecteurs généraux qui effectuent des tournées annuelles, par les
recteurs d’académie et leurs inspecteurs. Cette commission défendit fermement
le monopole universitaire et permit à l’État d’occuper, face à l’Église, toute
sa place dans la direction de l’enseignement. Elle prépara l’avènement d’un
ministère de l’Instruction publique qui vit le jour en 1824, alors qu’elle
avait été remplacée en 1820, par un Conseil Royal de l’Instruction publique
installé par Louis XVIII et présidé par Corbière. Les congrégations
triomphaient le 27 février 1821 grâce à une ordonnance de ce dernier qui
livrait l’Instruction publique aux mains des religieux. Désormais, les évêques autoriseraient,
révoqueraient et contrôleraient les instituteurs en imposant au passage un
Certificat d’instruction religieuse : « Les bases de l'éducation des collèges sont la
religion, la monarchie, la légitimité et la charte ;
— L'évêque diocésain exercera, pour ce qui
concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les collèges de son
diocèse ; il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires
généraux, et provoquera auprès du Conseil Royal de l'instruction publique les
mesures qu'il aura jugées nécessaires ;
— Le cours
de philosophie des collèges sera de deux ans ; les leçons ne pourront être
données qu'en latin. ».
Le 1er juin 1822,
Monseigneur Frayssinous est nommé à la tête de l’Université, grand maître et
président du Conseil Royal. A partir du 26 août 1824, il devient
ministre-secrétaire d’Etat des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction
publique. Dès lors, l’Eglise victorieuse développe les congrégations
enseignantes avec le soutien financier du gouvernement. Les associations de
religieuses hospitalières et enseignantes se multiplient et elles ont le
monopole des écoles de filles et même des écoles mixtes de campagne. Les instituteurs
laïcs restés en poste n’ont d’autre choix que d’accepter docilement le contrôle
du curé.
Revoir : article https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr/2017/06/les-chemins-de-la-laicite-francois.html#more
Le chemin vers la laïcité
(Deuxième partie)
(Deuxième partie)
Un instituteur républicain persécuté pendant la Deuxième
République
(1848 – 1852)
(2) : « Le
brevet de capacité put être remplacé par
le baccalauréat, la qualité de ministre d’un culte, ou par un certificat de
stage, ce qui favorisait les frères. Pour l’enseignement féminin, on admit même
que suffirait aux sœurs une lettre d’obédience que leur supérieure leur
remettrait, et qui attesterait leur appartenance à une congrégation. »
(Histoire
de l’enseignement en France-1800-1867, Antoine Prost)
(3) : De Parieu succéda à Falloux, il
fut ministre de l’Instruction publique et des Cultes du 31 octobre 1849 au 24
janvier 1851. C’est lui qui présenta la fameuse « loi Falloux », son
prédécesseur. Votée après 2 mois de débats, elle établissait dans
l’enseignement primaire et secondaire le principe de la liberté (en opposition
avec le décret napoléonien de 1808 créant l’Université et son monopole), en
donnant maints avantages à l’enseignement confessionnel et congréganiste. Bien
que modifiée par les lois de 1882 et 1886 sur la laïcité de l’enseignement et
par les lois de 1901,1902 et 1904 aboutissant à l’interdiction de
l’enseignement congréganiste, elle n’a jamais été abrogée.
(4) : Victor Duruy rédige la loi du 10
avril 1867 dite « loi Duruy » il est alors ministre de l’Instruction
publique de 1863 à 1869, poste qu’il accepta à condition qu’il fut séparé du
ministère des cultes. Sa loi marque quelques avancées significatives en obligeant
les communes de plus de 500 habitants à créer une école de filles alors que la
loi Falloux du 15 mars 1850 avait fixé le seuil à 800 habitants. Dans le même
temps, il les encourage à prendre des mesures en faveur des familles indigentes
afin de leur permettre de disposer de la gratuité des études, leur demandant de
fonder une caisse des écoles. Voici les principaux articles de cette loi :
ARTICLE PREMIER. — Toute
commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une
école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil
départemental, en vertu de l'art. 15 de la loi du 15 mars 1850. Dans toute
école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition
du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son
traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.
ART.
2. — Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans
chaque commune est fixé par le Conseil départemental, sur l'avis du conseil
municipal. (..)
ART. 3. — Toute commune doit
fournir à l'institutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice
adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation
que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement. (..)
ART. 8. — Toute commune qui
veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l'art. 36 de la loi du
15 mars 1850 d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites peut,
en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même
loi, affecter à cet entretien le produit d'une imposition extraordinaire, qui
n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre
contributions directes. En cas d'insuffisance des ressources indiquées au
paragraphe qui précède, et sur l'avis du Conseil départemental, une subvention
peut être accordée à la commune sur les fonds du département, et, à leur
défaut, sur les fonds de l'Etat, dans les limites du crédit spécial porté
annuellement à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique. (..)
ART. 15. — Une délibération
du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune,
une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de
l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves
indigents. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de
subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir,
avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs. Plusieurs communes
peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette
caisse. Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le
percepteur.
ART. 16. — Les éléments de
l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières
obligatoires de l'enseignement primaire. (..)
ART. 20. — Tout instituteur
ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil
départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien,
est passible des peines portées à l'article 29 de la loi de 1850.
ART.
21. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du
Conseil départemental, recevoir d'enfants au-dessous de six ans, s'il existe
dans la commune une salle d'asile publique ou libre.
Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique 1863-1869
Lithographie par A. Lafosse, Mayer, Pierson, J. Lemercier et Cie
Musée national du château de Compiègne
© Musée national du château
de Compiègne
Musée national du château de Compiègne
© Musée national du château
de Compiègne
P.P




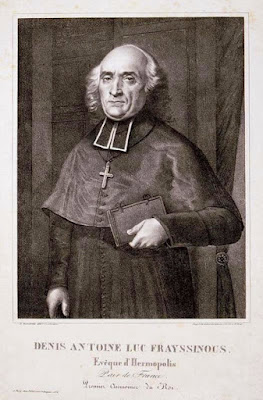


trés intéressant
RépondreSupprimer