Les
conférences du Musée de la Maison d’Ecole
Dix
ans déjà
« LA
REDACTION »
Conférence de
présentation à l’Auditorium de Montceau-les-Mines (2008)
Patrick PLUCHOT
Président du Musée de la
Maison d’Ecole-écomusée Le Creusot/Montceau Musée de France
Le propos : (texte intégral de la conférence)
« Introduction :
Nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long travail
de recherches, mené par les membres du musée de la Maison d’Ecole.
Un des sujets d’étude privilégié par le
groupe de travail pédagogique du Musée est celui de l’histoire sociale et de la
sociologie historique de l’éducation. Il tend à expliquer les fonctionnements
qui lient l’histoire de l’école aux mécanismes de la reproduction sociale et à
la formation des mentalités collectives. L’accent est mis sur la sociologie des
élèves et des enseignants, ainsi que sur le discours éducatif analysé à partir
des textes et directives officielles, des manuels et de la presse pédagogique.
C’est cette diversification des approches qui
a guidé la définition des objectifs de notre Musée : rédaction d’une
monographie, création d’un musée d’éducation et constitution d’un conservatoire
éco muséographique qui préserve le patrimoine local dont font partie les
productions des élèves de toutes époques.
L’album pédagogique que nous produisons cette année met en avant la
rédaction au fil du temps. Il est le premier recueil qui met à jour les
trésors « écrits » du musée de la Maison d’Ecole. Nous espérons qu’il
apportera, sans prétention, un éclairage sur le contenu des disciplines
d’enseignement à l’école élémentaire… voilà tout… L’analyse proposée montre
néanmoins l’importance de la sauvegarde et de la préservation locales des
cahiers et travaux des élèves de toutes époques et l’importance aussi de leur
mise en valeur auprès du grand public.
Dans La Rédaction, nous avons
retenu, arbitrairement sans doute, 75 textes d’élèves (pratiquement tous issus
du département) couvrant la période 1878-1988. Tous les niveaux y sont présents
du cours élémentaire au cours complémentaire et la parité garçons-filles a été
respectée. Les travaux d’élèves présentés reflètent un enseignement et des
sujets communément retrouvés à l’échelle nationale. De fait, cette dimension
comparatiste fait de notre travail, un singulier qui renvoie à un pluriel, au
lieu d’un anecdotique qui ne renvoie à rien. Ces
textes s’articulent autour de six thématiques qui nous ont parues les plus
représentatives de ce qui fut imposé par les instructions officielles des
différentes époques.
Nous
n’avons pas choisi la facilité en traitant du sujet épineux de la rédaction à
l’école primaire. Cet enseignement a, de tout temps, soulevé la polémique, du
milieu du 19ième siècle jusqu’à même 2008.
D’une manière
générale, dans l’école d’avant Jules Ferry, la rhétorique imprimait sa marque aux
classes élémentaires avec des exercices d’amplification de groupes de mots,
puis de phrases, doublés de mémorisation d’expressions stéréo typiques, sorte
de lieux communs, avec des exercices de style et d’écriture-réécriture d’autres
textes.
La rédaction, apparue
au milieu du XIX° siècle, et imposée dès 1882, était une ouverture, même
modeste, à l’expression des idées de l’élève et en cela, elle constituait une
avancée, bien qu’en ces temps, rédiger n’était pas fondamentalement travailler
la langue écrite pour faire naître du neuf, c’était plutôt mettre en forme
écrite, avec un langage le mieux construit possible, des choses que l’on savait
déjà. Le bond dans le temps qui nous rapproche des Programmes de 2008 nous
éloigne-t-il vraiment de cet état d’esprit ? Peut-être pas. Les temps
n’auraient-ils pas changé ?
La réapparition de la
rédaction dans ces nouveaux programme (enseignement qui n’avait d’ailleurs pas
disparu des pratiques enseignantes), cette réapparition donc, nous interroge,
moins au niveau du terme qu’au niveau de l’idée qui l’accompagne, selon
laquelle un élève d’école primaire ne serait pas capable d’un rapport créateur
à la langue. Certains pédagogues pensent, en effet, que ré instancier, si on
peut dire, la rédaction comme production écrite phare en français au cycle 3,
c’est ignorer d’abord les recherches pédagogiques sur l’écriture du groupe EVA
dans les années 1980, c’est ignorer aussi le travail des brouillons (Fabre,
1990), ignorer la réflexion sur les écrits intermédiaires (Chabannes &
Bucheton, 2000), ignorer le travail de l’écriture littéraire (Tauveron &
Sève, 2005). Ils pensent aussi, comme Doquet-Lacoste, que je cite : c’est
faire fi « du vaste champ de recherche que constitue aujourd’hui
l’écriture, littéraire ou non, dans les domaines de la littérature, de la
critique génétique, de la linguistique, de la sociologie, de l’anthropologie.
Dans ces différents champs scientifiques, l’étude de l’écriture est celle d’une
activité humaine – sociale, culturelle, linguistique – dans laquelle entrent en
jeu des composantes complexes et que l’on n’envisage plus aujourd’hui comme la
transcription d’un oral supposé en écrit mais comme l’élaboration d’un discours
singulier, dans lequel le matériau, la langue écrite, inséparable de ses dimensions
symboliques, joue un rôle prépondérant. Que sont des Programmes qui
négligent les convergences de la recherche en sciences humaines pour remettre à
la première place un genre d’écrit, la rédaction, qui n’a jamais existé qu’à
l’école, eu égard à la nécessité reconnue par ailleurs de favoriser les liens
entre cette même école et le monde extérieur ? » . Fin de citation, la
polémique n’est donc pas morte.
Pourtant, déjà en
1923, les Instructions pour l’Ecole Primaire rédigées par Paul Lapie montraient
la nécessité de l’apprentissage de savoirs en prise avec le monde dans lequel
évoluaient les élèves. En 1963, la reprise par le parti communiste du rapport
Langevin-Wallon de 1947 (jamais appliqué au demeurant), pointait du doigt les
connaissances sclérosées qui faisaient alors l’objet d’un enseignement
systématique, sans lien avec les usages langagiers qui étaient ceux des élèves
et qui seraient les leurs à l’âge adulte. L’Institut National de la Recherche
Pédagogique, depuis 1970, souligne la nécessité pour l’école de s’appuyer
aussi, mais pas exclusivement, sur des productions langagières orales ou
écrites des élèves, ainsi que sur des textes non spécifiquement scolaires, pour
étudier la langue et son fonctionnement.
A l’heure où
l’expression écrite, y compris dans ses éditions savantes s’appuie non
plus sur les sacro-saints « exemples de grammaire » mais sur des énoncés
attestés pour caractériser et analyser la langue, faut-il que cette ouverture
aux usages, observable dans le champ linguistique depuis les années 1960,
devienne lettre morte quand on s’adresse à des enfants ? Evidemment, la
scolarité obligatoire doit faire acquérir un système morphologique strict,
mais, comment nos élèves parviendront-ils à rendre opératoires les savoirs
transmis si les apprentissages ne se font pas en connexion avec les usages
sociaux et médiatiques en vigueur ? La question est d’importance.
Sans entrer trop
avant dans le contenu du livre qu’il vous appartient de découvrir, je vais
tenter une explication rapide quant au choix des thèmes retenus.
1
/ : Le premier chapitre du livre s’intitule : les Choses vues :
Ce
premier thème « des choses vues » élargit le champ de la description
dans les rédactions d’élèves, à une réalité plus large souvent liée au récit.
Là encore, l’ambiguïté doit être levée : la description
ne vaut pas seulement pour elle-même, en tant qu'imitation d'une
technique littéraire ou d’un apprentissage grammatical. Elle établit aussi une
relation entre l'extérieur et l'intérieur, la nature et les sentiments de celui
qui la contemple. En décrivant sa vision, l’élève exprime son ressenti.
Il suffit de lire les rédactions proposées
pour s’en persuader. Du reste, et pour donner un exemple concret, les grandes
fresques de Zola qui décrivent les Halles dans Le Ventre
de Paris ne sont-elles pas des documents ? A leur manière, les
descriptions faites en classe en sont aussi. Au sein de cet ouvrage, l'utilité des descriptions apparaît beaucoup
plus clairement. Bien loin de se réduire à des morceaux détachables purement
décoratifs, les descriptions sont des lieux textuels saturés de sens. Eluder les descriptions, comme le font parfois les lecteurs pressés,
aurait fait prendre le risque de manquer une très grande part de l'information
sur une époque : la physionomie, l'habillement, l'ameublement et tout
l'environnement des personnages révèlent leur psychologie et la justifie.
Au fondement de cette relation,
il y a une théorie implicite du milieu : les êtres sociaux, comme les êtres
vivants, sont en adéquation avec le milieu où ils vivent et par conséquent sont
interprétables à partir de lui. On sait comment, dans Le
Père Goriot, Balzac fait de la pension Vauquer le symbole de ses
occupants…
Les dix-huit productions de ce chapitre
s’échelonnent de 1902 à 1988. Dans une première série de textes, en bonne
conformité avec la pédagogie instructive de la leçon de choses, l’élève doit
décrire des objets qu’il a devant les yeux et dont il doit dire l’aspect, mais
aussi la fonction, la fabrication, le fonctionnement, l’utilité (« Le
verre à boire » 1902, « La pièce de cinq centimes », 1908, « La
montre de la maîtresse » 1915, « La lampe de notre classe »
1913). Il ne suffit donc pas de regarder, il faut avoir retenu les informations
entendues en classe : comment on fabrique le verre, ce qu’on peut
« faire » avec un sou (achat, économie, charité), comment fonctionne
la lampe à pétrole. Tous ces exercices sont appelés « rédaction » et
une série de questions, parfois recopiées sur le cahier, prépare l’enchaînement
des phrases. La diffusion progressive de livres de sciences spécialisés fait
disparaître des livres de lecture ces textes « instructifs » qui
servaient de modèle d’écriture : on n’en trouve plus guère au-delà de
1923.
La description peut s’élargir à la
restitution d’un lieu, d’une scène, d’un personnage, sous l’intitulé de
« composition française ». De telles descriptions sont fréquemment
intégrées à des récits dans les morceaux choisis littéraires qui servent aux
lectures quotidiennes, elles perdurent donc mais leur style évolue lentement. « La
salle de classe » est un grand classique, dont deux versions sont
présentées, finalement assez stables entre 1908 et 1960, puisqu’elles suivent
le même plan. La liste des points à aborder est donnée en 1960 : « Aspect général, Orientation,
Éclairage, Mobilier, Décoration, Impressions et Résolutions ». Dans
les deux cas, on a la phrase conclusive d’adhésion : « je me plais à l’école » dans la rédaction 1908 et « je veux rester dans cette classe car
je l’aime bien, j’espère faire du bon travail » dans celle de 1960).
Il s’agit d’une formule de clôture, aussi formelle et commode qu’une formule de
politesse au bas d’une lettre, et, évidemment, personne n’y voit un engagement
véritable...
Si l’élève a la salle de classe sous les yeux
quand il écrit, il n’en est pas de même des autres descriptions qu’il ne peut
qu’évoquer de mémoire : « L’endroit le plus animé du village »
(1911), « Le chien de berger » (1936), à moins qu’il ne s’agisse de
décrire l’image d’un livre ou d’une autre affichée dans la classe. C’est
certainement le cas quand il s’agit de dénoncer la brutalité envers les animaux
avec la scène du cheval battu par le charretier brutal (1909), ou d’évoquer
l’affairement joyeux des vendanges, qui ne devait guère être de mise en pleine
guerre, à l’automne 1917 : ces scènes ont été souvent représentées dans
les livres de lecture, dans les vignettes en noir et blanc illustrant les
manuels.
Avec les nouvelles instructions de 1923,
faisant une place plus importante aux « centres d’intérêt de
l’enfant », les sujets évoluent vers les récits d’expériences. Dans les
écrits, l’observation directe faite par l’élève est sensible, quelles que
soient les aides collectives à la formulation faites en classe : « La
course à pied » en 1929, « Le froid » du 16 au 22 décembre 1950,
qui est un texte collectif rassemblant les observations des enfants faites
spontanément ou lors d’une « étude de milieu », « La roulée des
œufs de Pâques » en 1945, « La marchande ambulante de fruits et
légumes » en 1956.
En revanche, dans les narrations de la
dernière période, l’élève doit faire la preuve qu’il saura évoquer de façon
plausible la situation demandée, qu’elle soit de pure imagination (« Allo,
la base ! » 1978), ou qu’elle renvoie à une situation réaliste,
sinon vécue. C’est le cas avec « Le récit d’une belle histoire »
(1962), « L’achat d’une robe dans un magasin » (1974) et surtout
« La promenade au printemps en forêt » (1988), qui rassemble, aussi
bien que chez Walt Disney, tout ce qu’on peut attendre de clichés rassurants
sur les fleurs, le soleil et les petits oiseaux, jusqu’à la conclusion
immuable : « Il est déjà tard
et nous repartons, fatigués mais joyeux de notre belle promenade en
forêt ». En un siècle, on est ainsi passé d’une écriture totalement
guidée et encadrée, à un exercice supposant que les élèves ont une maîtrise
implicite suffisante des codes narratifs et des stéréotypes attendus pour
conduire d’eux-mêmes ce genre d’évocation en situation scolaire : de fait,
on mesure l’intensité des exercices sans lesquels ce résultat, pourtant
modeste, n’aurait pu être atteint.
2/ : Le second chapitre est celui des thèmes moraux et
civiques :
L’enseignement moral et religieux est
remplacé dans les Programmes des Ecoles Primaires de 1882 par le double
enseignement moral et civique. Le « Hussard noir de la République »,
cher à Péguy, doit cependant faire connaître à ses élèves les devoirs des futurs
citoyens qu’ils seront : « envers l’âme, envers le corps, envers
ses maîtres, envers la famille, envers la Patrie, envers Dieu »…bien
que la morale républicaine n’accepte le gouvernement d’aucune religion. Notons
au passage que ce ne sera qu’en 1906 que l’édition du livre scolaire Le tour
de France par deux enfants, qui fut un pilier de l’enseignement du
français, sera laïcisée, André et son frère abandonnent la prière du coucher et
ne disent plus « mon Dieu » mais « Hélas ! ».
Doit-on y voir un effet des lois Combes ?
Jules Ferry met en garde le corps
enseignant au nom de la « neutralité » : « vous ne
toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose sacrée, qui est la
conscience de l’enfant ».
La morale vécue et la morale enseignée
doivent être confondues. Cependant, les principes et la discipline inculqués
aux écoliers se révèleront bientôt être trop souvent liés à des contraintes
d’adultes : respect de l’argent, respect de la loi, respect de l’ordre.
Les manuels de lecture proposent des thèmes de rédaction dans ce sens. Les
Instructions de 1923 dissocient clairement enseignement moral et enseignement
civique et les « devoirs envers Dieu » disparaissent. Au
demeurant, les priorités du culte républicain de l’idéal de l’homme (qui
répondait à un souci des réalités urgentes : « le travailleur, le
citoyen et l’homme »), voient cette dernière notion se développer au
détriment des deux autres.
Ce glissement s’amplifiera jusqu’à la
disparition de la morale en temps que telle dans les écoles. De même, après la
grande guerre, on ne fera plus composer les élèves sur les « textes
édifiants » qu’étaient : le respect dû aux parents et aux soldats ou
encore les victimes du devoir.
Le
changement est notoire dès 1923, les sujets proposés décrivent des
comportements concrets : la gourmandise, le caprice, l’application
scolaire…
S’il est difficile de s’entendre
sur les devoirs envers l’âme, un consensus peut s’établir sur les devoirs
envers le corps et des générations d’élèves ont vu les affiches éditées vers
1890 (« L’alcoolisme voici l’ennemi ! »), opposant le foie sain
au foie rongé par la cirrhose et l’homme normal à l’ivrogne aux yeux effarés,
zombie à la pupille vert pâle, couleur d’absinthe.
Jusqu’en 1920, les manuels de
lecture commencent par des textes moraux mais en 1923, la morale est séparée de
l’instruction civique et le calendrier des textes à lire change. On débute avec
l’automne, la rentrée, les vendanges et non plus par les Devoirs envers les maîtres.
« Vices et vertus » deviennent « Qualités et défauts », où
on décrit des comportements sans distribuer blâme et louange. Les méthodes
actives prônent l’échange oral autour des « cas » qui se présentent
dans la classe ou dans l’actualité, consacrant une pédagogie de la
« morale occasionnelle » : c’est la fin de la leçon de morale
matinale qui s’achevait par une maxime ou une bonne résolution. De ce fait, la
morale disparaît des disciplines scolaires, sinon des soucis enseignants. Mais
les efforts se déportent vers d’autres entraînement d’écriture :
descriptions et récits, comme nous l’avons vu.
Les devoirs sur les « Thèmes
moraux et civiques » s’arrêtent donc en 1945, bien avant que la morale ne
disparaisse des programmes, en 1968, comme l’avait noté Jean Baubérot étudiant
les cahiers d’écoliers (La morale laïque
contre l’ordre moral, Paris, Seuil, 1997). On a retenu deux textes de 1878,
témoins d’une présence religieuse disparue après 1882 (la visite du curé, la
prière du réveil). Les textes, écrits par 7 filles, 3 garçons, 2 anonymes, sont
peu corrigés (3 sont -mal- notés, 7 non corrigés, 2 corrigés mais non notés).
C’est qu’ils s’avèrent difficiles à évaluer : comment ne pas décourager la
sincérité maladroite ? Comment traiter le conformisme hypocrite ?
Quand la morale est un objet
d’écriture écolière, quels sont les sujets abordés ? L’art du portrait
domine : en quelques lignes, il s’agit de caractériser le bon écolier
(1909), le « souillon » (1908), l’enfant propre et ordonné (1935), le
petit capricieux (1945) : « Le
bon écolier fait toujours bien ses devoirs, il aime son maître, il travaille
toujours avec ardeur ». On présente aussi en couple qualité et défaut,
comme ordre et désordre (« autant
Émile est actif et soigneux, autant Jules est négligent et nonchalant » 1878),
coquetterie et bonne tenue (1902). Enfin, on recourt au récit édifiant. Dans
« Un brave cœur » (1909) le bon élève courageux prend la défense de
l’orphelin, pauvre et brimé, et « les
méchants camarades tout honteux le prennent en pitié et lui demandent
pardon ». Ces historiettes morales sont rarement réussies, surtout
quand l’élève doit s’y mettre en scène et arriver à la chute prévue (« bon
écolier, bon citoyen »).
Le changement de style est patent
après 1923. Les textes décrivent des comportements concrets : la bonne
élève de 1935 « s’applique de son
mieux pour écrire, ne faisant pas une tache, tirant des traits droits et ne
cornant pas son cahier ». Les anecdotes relatées (l’enfant capricieux
qui refuse de dire bonjour, la gourmande qui mange le gâteau familial) ont la
qualité des « choses vues et vécues » sans grande émotion ni
moralisation.
S’agissant des
thèmes civiques, Berthe (CM2) rappelle en 1911 que le suffrage universel
est une conquête historique (« tout
le monde n’avait pas le droit de voter, seulement les riches parce qu’il
fallait payer, c’est en 1848 que le député Baudin fut tué parce qu’il voulait
le suffrage universel ») Qui se douterait qu’elle est dans une école
privée ? Germaine (15 ans) doit élargir le sens de « mourir au champ
d’honneur ». Toutes les victimes des accidents du travail sont-elles
« victimes du devoir » ? Oui, répond Germaine, non, dit son
professeur, qui lui met tout juste la moyenne. Enfin, dans « Un jeune
homme ivre et son père soldat » (1918), Hélène réunit tous les thèmes qui
habitent l’époque : ravages de l’alcoolisme, respect dû aux parents et aux
soldats, honte publique du fils et du père. En quelques lignes, elle fait
converger les enfants sortant de l’école, le jeune voisin pris de boisson (« je le regardais tristement songeant
au chagrin que sa mère éprouverait à le voir rentrer dans cet état »),
et le père arrivant du front, sortant de la gare. « Monsieur Lebois était devenu tout pâle : « Suis-moi »,
dit-il à son fils. Et les deux hommes s’en allèrent ». De fait, ce
récit qui fait sentir sans expliquer est une fiction littéraire : le
maître n’aurait pas permis de citer de vrais noms propres. Faire sentir :
les savoirs de la morale ne se transmettent pas comme ceux qui portent sur
l’hygiène. Après la Grande Guerre, on ne fera plus écrire de « textes
édifiants ».
3 : Vient
ensuite le thème du style et de la littérature :
Un long chemin a été parcouru depuis
l’enseignement du style jusqu’à l’Observation Réfléchie de la Langue et l’imprégnation littéraire préconisée dans les
Instructions de 2002. En 1882, si la lecture et l’écriture sont sans contredit
les premières connaissances à enseigner, ces matières ne doivent pas être
dissociées de l’apprentissage de la langue française. Il est recommandé de faire des exercices de style dès le cours
élémentaire, plus appuyés au cours moyen à travers des règles simples de
grammaire à partir d’exercices « d’invention » s’appuyant sur des
lectures du maître (les enfants « manquant » souvent d’idées…). Dans
le cours supérieur, arriveront les règles de syntaxe et d’analyse logique à
partir de lecture de textes tirés de nos grands auteurs dont on aura étudié le
développement ou le canevas.
Les
nouveaux programmes de 1923 introduisent un allègement, une plus grande liberté
pour les maîtres et des innovations dans
la méthode en Composition française : on conseille de ne pas trop mâcher la besogne dans les
consignes, de faire choisir l’enfant à son goût dans plusieurs sujet, voire
même d’en inventer un. La réforme de l’enseignement des années 60 avec
notamment l’entrée massive des enfants au collège, tente de recentrer les
apprentissages du français autour de la lecture ne laissant à l’expression
écrite qu’un rôle de réinvestissement des notions d’une grammaire allégée.
Les sujets de rédaction liés à l’étude des
grands auteurs ou de l’histoire littéraire de la France ne sont souvent que des
reconstitutions de textes faites à la suite d’une lecture, une « copie
différée » en quelque sorte, dans la plus pure tradition du secondaire et
des versions latines. Cet exercice est peu probant pour les élèves de cours
moyen… Au demeurant, les rédactions ne portent que sur des versions abrégées
des œuvres que l’on trouve dans les manuels élémentaires. La
« primarisation » des exercices du secondaire prendra fin entre les
deux guerres.
À travers les 5 reproductions photographiques
en couleur de ce chapitre, le lecteur percevra l’évolution des normes
d’écriture, d’abord dans le sens matériel du terme. Sous la permanence de cahiers
lignés de petit format, un œil prévenu distingue trois réglures, d’abord simple
(1878, 1910), ensuite à carreaux avec une subdivision horizontale et verticale
(1917), enfin, à réglure Seyès[1] 8x8
mm, imprimée en violet sur fond blanc (1936, 1989), avec les quatre interlignes
horizontaux si utiles pour calibrer la hauteur des jambages lors des exercices
d’écriture. Comment écrivent les élèves ? Encre noire, violette, puis
bleue, écriture alternant italique et droite pour les titres (1878), ronde
(1910), anglaise (1917), « presque droite » (1936) et enfin droite
(1989). Quand Brigitte Dancel a publié Un
siècle de rédactions. Ecrits d'écoliers et de collégiens (CRDP, Grenoble,
2001), elle était frustrée de ne pouvoir montrer l'écriture du maître sur celle
de l'élève (l’encre rouge de nos inconscients scolaires), le jeu des marges qui
s’élargissent lorsqu’on économise moins le papier, les repentirs, hésitations,
fautes d’orthographe, plus ou moins rares selon l'aisance des élèves et selon
que le devoir a été précédé ou non d’un brouillon corrigé.
Ici, sans qu'il soit besoin de commentaires,
on voit que la "mise en page" conditionne la "mise en
texte" et à quel point la lecture est influencée par la présentation (la
position du titre, la marge, les paragraphes, la lisibilité de l’écriture). Sur
ce point, l’échantillon offre un éventail très ouvert, sans qu’on puisse dire
que les belles écritures soient le privilège du passé et les écritures
d’aujourd’hui soient particulièrement négligées, mais il est sûr que chaque
élève, qu’il fasse ou non une « bonne rédaction », a intériorisé des
normes graphiques de présentation qui font partie intégrante du « travail
d’écriture », mêlant de façon inséparable « forme et fond ».
Quels sont donc les contenus regroupés sous l’entrée
«Style et littérature » ? Le devoir de 1878 donne un exemple des
exercices de « style », encore proposés sous Ferry pour préciser le
vocabulaire des élèves sur un modèle secondaire du travail de la langue. Par
contraste, la rédaction sur « Les Gendarmes » (1908) montre les
nouveaux choix pédagogiques pour enrichir le lexique, à partir d’une entrée
thématique renvoyant à un « champ sémantique » en situation d’usage,
bien plus en phase avec une « pédagogie concrète ». Le devoir sur
Androclès, reconstitution de texte fait d’après une lecture (ou plutôt une
« copie différée », avec le texte non loin des yeux), est dans la
tradition secondaire puisqu’il s’agit d’un classique des versions latines,
alors que la biographie de Ronsard, qui relève de la même procédure de travail
(on voit dans les répétitions du texte des erreurs de « copie ») fait
entrer à l’école l’histoire littéraire de la France. Cette jeune discipline
universitaire en passe de remplacer la rhétorique est entrée dans la préparation
au Brevet Supérieur et les maîtres la resservent dans les écoles primaires
supérieures et les cours complémentaire.
Même contraste entre les deux textes suivants
de 1912 et 1917 : l’élève ne parvient pas à « développer » le
commentaire de la phrase de Voltaire faisant l’apologie du travail, et à lire
ce devoir raté, on voit combien ce « genre littéraire »
est dénué de sens pour celui qui enchaîne absurdement les lieux communs
entendus en classe, sans parvenir à construire le moindre texte. En revanche,
Berthe répond parfaitement à la consigne en racontant le grand classique
de littérature de jeunesse, Sans Famille.
Elle l’a probablement lu dans la version abrégée (Capi et sa troupe, paru en 1892 et sans cesse réédité à l’usage des
écoles primaires) puisqu’elle ne cite pas le titre d’Hector Malot, mais elle
conduit son récit sans prétention avec cohérence et intelligence jusqu’à son
terme.
La paraphrase en prose de la Fontaine vaut à
Eugène, élève d’un cours complémentaire (1917) une très mauvaise note, car s’il
a « compris » l’argument et la morale de la fable, la maladresse de
l’écriture rend l’exercice peu probant. Faut-il donc penser que les contenus de
la littérature classique ne sont pas accessibles aux élèves du primaire ou bien
est-ce la forme d’exercice qui est inadaptée ?
En 1936, l’institutrice qui demande à Denise
le portrait de Ménalque renvoie non au texte de La Bruyère, mais à
l’illustration qui précède l’extrait publié dans Lecture et Langue Française (Lyonnet et Besseige, CM2, 1933, p.
150). Décrire la scène des courtisans représentés sur une image, voilà qui est
à la portée d’une élève de CM2, alors qu’il serait absurde de lui faire
paraphraser ou résumer « le Distrait ».
On comprend à ces lectures l’extinction du
genre entre les deux guerres mondiales. Le travail sur la langue littéraire ne
peut se faire en « primarisant » les exercices du collège. Les
Instructions de 1923 en inventant une pédagogie de la lecture expressive et de
la récitation sauvent la mémoire du patrimoine littéraire, en excluant la prétention
des commentaires de textes ou des dissertations littéraires. Il faut attendre
que la pédagogie du texte libre, mise en place par Freinet dans les années
1930-1940, ait des retombées dans les écoles ordinaires pour qu’on demande aux
enfants d’inventer des poésies (1945). Lorsque Maud s’essaie au compte-rendu de
lecture (mais sans avoir le texte sous les yeux), on est dans une pédagogie de
l’articulation lecture-écriture : le patrimoine des contes populaires et
de la littérature pour la jeunesse fait maintenant de plein droit partie des
lectures scolaires.
[1] Brigitte Dancel a retrouvé le brevet déposé au tribunal de Pontoise par le libraire Seyès le 16 août 1892 faisant de la réglure qui porte son nom une marque déposée. Ces cahiers « à grands carreaux » sont une originalité française unique au monde. Cf. Brigitte Dancel, Le cahier d’élève : approche historique, in S. Plane et B. Schnewly Les outils d’enseignement du français, Repères, n° 22, 2000.
4/ : Le chapitre
4 traite du thème de la lettre :
Quelle discipline est plus contraignante pour
l’élève que celle de la rédaction ? Lui qui est habitué à parler et non à
écrire, chose qu’il fait spontanément dans sa langue maternelle et qui, de
toute manière, si elle n’est plus le patois ou la langue populaire, n’en reste
pas moins la langue courante.
L’apprentissage de la lettre est
historiquement marqué. C’est peut-être en cela que réside le progrès de l’école
obligatoire, laïque et gratuite de Jules Ferry. Le citoyen aura désormais et
pour longtemps accès à une communication élargie dans l’espace : il pourra
écrire ces courriers qui brisent la solitude sociale, morale et culturelle de
tout analphabète. Cet aspect est un sujet courant de rédaction. Granadou,
beauceron « lisant et écrivant », se souvient avec fierté d’avoir, au
régiment, tenu la correspondance amoureuse d’un percheron illettré.
Mais les avantages de savoir écrire ne sont
pas moins évidents aux travailleurs qui cherchent à améliorer leur condition,
individuelle ou collective. Il suffit, pour s’en persuader, de revoir les récits autobiographiques de
Perdiguier, Nadaud ou Dumay. Nous avons tous hérité de ce savoir nouveau. La
grammaire et la maîtrise épistolaire, pour nos aïeuls, n’était donc pas
seulement l’agent d’une unification culturelle nationale ou d’un pseudo
impérialisme culturel, elle était aussi, à l’évidence, agent d’émancipation et
de mobilité géographique. Les bouleversements engendrés par les nouvelles
technologies de la communication ne doivent pas nous faire oublier la source…
La lettre mêle la forme et le fond et l’étude
des cahiers des élèves d’autrefois est une mine de renseignements et
d’émotions. A toutes époques, le constat est le
même : l’observation de ces cahiers révèle d’incontestables réussites. On
peut suivre parfois, en étudiant la série des cahiers d’un enfant du cours
préparatoire à la classe de fin d’études, le lent cheminement qui conduit de
quelques mots groupés en phrases, de quelques phrases juxtaposées ne
développant pas le sujet ou si peu, à un texte structuré, grammaticalement
complexe et riche par son vocabulaire. On imagine mieux ainsi, le travail de
l’enseignant et le résultat des multiples contraintes qui aboutissent à
développer des capacités d’expression et de communication.
En 1854, le directeur de la Revue de l’enseignement primaire (revue
officielle du Ministère) met au nombre des textes que les élèves doivent
apprendre à écrire, la lettre car elle est « utile dans les relations
domestiques et les relations d’affaires ». En effet, tout au long de la
Monarchie de Juillet et du Second Empire, le développement du réseau postal accompagne
l’essor des chemins de fer et popularise les échanges épistolaires entre ceux
qui sont « restés au pays » et ceux qui sont partis travailler dans
les grandes villes.
Les maîtres font donc écrire des lettres à
leurs élèves, mais les « lettres d’affaires » sont peu à peu
délaissées (de nombreux manuels en offrent des modèles dans le commerce) alors
que perdurent les correspondances domestiques. Ces lettres fictives deviennent
des prétextes pour réciter des leçons scolaires de tout ordre (« vous écrivez à une amie pour lui raconter ce
que vous avez appris sur le cours de la Loire ») ou pour répéter à la
première personne les leçons de morale (sur le respect dû aux maîtres, aux
parents, le goût de l’étude, du travail bien fait, etc). Ce genre artificiel
devient donc un de ceux qui « répugne » le plus aux élèves, d’après
les inspecteurs. On comprend les efforts de Freinet pour lui donner sens dans
des correspondances scolaires reposant sur l’échange de lettres entre
classes.
Les
six lettres retenues donnent une idée des objectifs pédagogiques
poursuivis : la rédaction de 1906 est la plus proche de la valeur d’usage
visée à l’origine : une lettre sert généralement à annoncer une mauvaise
nouvelle (ici, l’accident du père). L’élève, qui écrit pour toute la famille,
doit anticiper une telle situation et savoir « mettre en phrase » le
canevas d’événements que fournira le jour venu l’infortune du sort.
En revanche, les autres lettres sont des
lettres de loisir : elles traitent de thèmes scolaires imposés, où
reviennent régulièrement distractions et vacances. On pourra comparer les deux
lettres de 1912, sur le thème rebattu de la lecture « ce loisir de bon aloi, qui repose, instruit, recrée… »
(F Buisson), ce dont les élèves sont d’accord en théorie plus qu’en pratique.
Germaine qui doit dire pourquoi « elle aime tant lire » s’en acquitte
avec plus de bonne volonté que d’expérience (« c’est surtout mon livre de science que j’aime beaucoup »).
Gabriel qui doit parler de tous ses loisirs de vacances répète la vulgate
scolaire (« je lis beaucoup de
livres que j’emprunte à monsieur l’Instituteur, le bon instituteur de mon
village qui m’apprit mes premières lettres et auquel j’ai tant donné de maux » ;
« cher ami, lis autant que tu
pourras car c’est en lisant qu’on s’instruit »). Trop
d’invraisemblance nuit ! Le correcteur décèle dans cette flatterie une
mauvaise lecture de la consigne (« il
fallait me trouver d’autres récréations : promenades à pied, à bicyclette… »).
Le récit de vacances dans les Alpes écrit
pour le Certificat d’Etudes Primaires trois générations plus tard (1979) n’a
pas de tel souci : les projets sont tous du côté du tourisme pédestre en
solitaire, ce qui malmène aussi la vraisemblance (que fait cet adolescent seul
« dans une auberge » ?). En 1956, Isabelle doit anticiper des
vacances à Paris : « vous remerciez
une parente de vous avoir invitée » et dites « ce que vous aimeriez voir dans la capitale ». Sujet
difficile : à part la tour Eiffel et un « tour de barque » sur
la Seine, que demander ? La fillette se trouve démunie, alors qu’on lui
aurait fourni les réponses convenables vingt ans plus tôt.
Reste à s’interroger sur les effets de cet
apprentissage. Par une chance exceptionnelle, nous avons retrouvé sur le dos
d’un cahier un brouillon de lettre personnelle. Dans ce document spontané,
Bernard annonce à son cousin qu’il a réussi au certificat (ce qui lui a donné
beaucoup de mal) et fait un portrait pittoresque de ses examinateurs. Il
« oublie » 14 fautes d’orthographe dans ce brouillon de 150 mots (ce
qui laisse un doute sur ce qu’évalue la dictée, puisqu’il a traversé
victorieusement cette épreuve), mais il utilise sans problème les codes
épistolaires exercés « à vide » en classe. Serait-il donc inutile de
passer par des situations authentiques et la correspondance scolaire chère
aux classes coopératives ? On ne peut tirer d’un indice aussi ténu une telle
conclusion, mais il montre en tout cas, que dans ce milieu statutairement
artificiel qu’est la classe, des exercices « très scolaires » ont pu
produire de véritables compétences.
5/ : Arrive au
chapitre 5 le thème bien particulier de la Grande Guerre :
Dès la création de l’école en tant que
service public, on compte sur elle pour faire progresser le sentiment national
par le développement du patriotisme, seule grande force unificatrice
susceptible de dépasser les oppositions idéologiques et sociales.
Le décret du 6 juillet 1882 crée les
bataillons scolaires, mais l’enthousiasme suscité est complètement retombé dès
1886, l’accent mis sur l’importance de l’armée ne saurait être réduit à un
quelconque militarisme. Dans la France républicaine, l’armée, c’est la nation
et, comme l’écrivaient Paul et Victor Margueritte dans leur « Histoire de
la guerre de 1870 - 1871 » : «
Plus la nation sera grande, plus elle aura la religion de ses devoirs et plus
l’armée sera forte ». L’essentiel demeure cette
« religion des devoirs » dont les ouvrages de lecture seront
longtemps imprégnés, cette conscience de la grandeur de la nation dont les
livres d’histoire et de géographie porteront témoignage. Bataillons scolaires
et exaltation militaire comptent peu en comparaison de la mise en œuvre de ces
objectifs dans le cadre de l’école, priorité absolue : « Pour que les citoyens, les soldats de demain se souviennent,
pour qu’ils prévoient, il faut que les enfants aient appris ».
Parallèlement, si la « communale »
a contribué largement à la formation d’une conscience patriotique, avec ou sans
bataillons scolaires, elle a aussi, d’une manière diffuse, provoqué par
l’accession au savoir, le refus de certaines formes de militarisme. Les
collèges de jésuites sous l’Ancien Régime avaient pu produire des penseurs
révolutionnaires, l’école primaire, les écoles primaires supérieures et les
écoles normales ont pu produire à leur tour, des instituteurs pacifistes, qui
furent malgré tout d’ardents patriotes au lendemain de la déclaration de la
Grande Guerre. Du reste, plus de 22 % d’entre eux mourront au combat.
Dès lors, en même temps qu’il décrypte les
lettres, l’écolier s’imprègne, à son insu, de ces trois pôles de la vie sociale
que sont le travail, la famille et la patrie, bien avant que Vichy n’en fasse
sa devise. Avec ou sans Dieu, l’école fonctionne comme un système de normalisation socioculturelle. Je dois
travailler, je dois aimer mes parents, je dois défendre ma patrie…
Cette
culpabilisation, héritée de 1870, intériorisée sur les bancs de la communale,
n’explique-t-elle pas l’union sacrée d’août 1914 ? Dès l’installation
imprévue du conflit dans la durée, en 1915, la conscience des écoliers est brutalisée par les
évocations de l’ennemi et des combats par la propagande et les maîtres, les
enfants dessinent et écrivent sur ce
thème.
Plus tard, l’école se pliera au devoir de
reconnaissance envers les combattants et aussi au deuil collectif avec la loi
du 24 octobre 1922 qui fixe les modalités de commémoration du 11 novembre
auxquelles les écoles sont associées. Cependant, la grande majorité des maîtres
du primaire s’emparent des instructions de 1923 puis de celles de 1938 pour
donner une orientation pacifique à leur enseignement. Si les enseignants en
question refusent l’idée de fascisme et de guerre, il est malheureusement
d’autres voix qui s’élèvent dans leurs rangs pour proposer, à l’instar du
Maréchal Pétain en 1934, une éducation de la jeunesse sur les modèles autoritaires
de l’Allemagne ou de l’Italie.
L’essentiel est cette « religion des
devoirs » dont les livres de lecture sont longtemps imprégnés, cette
conscience de la grandeur de la nation dont les livres d’histoire et de
géographie portent témoignage, comme Le
Tour de la France par deux enfants, de G. Bruno, diffusé à 6 millions
d’exemplaires entre 1877 et 1900. Des écoliers de toute la France ont lu
l’histoire de Julien et André Volden, qui après le décès de leur père quittent
Phalsbourg occupée par les Prussiens pour rechercher leur famille. Ils vont de
région en région découvrir les beautés de cette Patrie, amputée de l’Alsace et
de la Lorraine qui figurent toujours en grisé sur les cartes de France de
l’époque, cette France toujours unie et laborieuse dans la diversité de ses
« petites patries ».
La guerre de 1914 à 1918 vide les écoles des
instituteurs mobilisables. Ceux qui sont restés en poste et les institutrices
qui prennent en charge des classes de garçons relayent des événements au fur et
à mesure de leur déroulement : cartes géographiques du front, chansons de
Déroulède, dessins de soldats en uniforme, lettres aux poilus font partie de la
vie ordinaire des classes, d’une façon qu’on a aujourd’hui peine à
imaginer : on ne cherche pas, en tout cas, à préserver les enfants de la
réalité de la guerre, de ses souffrances et de ses deuils. La première
rédaction présentée témoigne de la rentrée 1914, retardée au 3 octobre (« nous ne sommes pas dans notre classe, elle a
été transformée en ambulance, nous sommes dans une salle de la mairie »).
Trois devoirs (de 1916 et 1917) traitent du
soldat blessé de retour du front. Eugène rapporte au style direct un récit qui
part sans doute d’un témoignage réel entendu à la veillée avec ses parents,
mais qu’il a dû retranscrire au passé simple pour respecter les normes
scolaires (« nous allâmes prendre
part à la bataille de Charleroi, nous reculâmes ensuite jusqu’à la Marne »).
Hélène se contente d’imaginer à partir des clichés patriotiques lus ou entendus
(« A la vue de ces pauvres éclopés,
ma pensée partait vers le champ de bataille d’Alsace »). Dans un autre
devoir, la même Hélène imagine, comme on lui demande, l’histoire du soldat
mutilé qui malgré sa jambe en moins « travaille
courageusement pour nourrir sa petite famille » et « aucun ne songe à se moquer de son infirmité ».
Dans les trois cas, le devoir s’achève sur les sentiments de respect,
d’admiration, de reconnaissance que les enfants éprouvent à l’égard des soldats
héroïques.
Trois autres sujets, plus proches de la
« dissertation » que de la rédaction, sont intéressants du fait même
de leur difficulté, qui les met presque hors de portée d’élèves du
primaire : s’agit-il de sujets proposés dans des revues pédagogiques qui
ont semblé possibles du fait de lectures préparatoires que nous ignorons ?
Dans l’un, il s’agit de dire si les Français sont ou non trop oublieux du passé
et « quels sont les enseignements de
cette guerre et les souvenirs personnels que vous vous efforcerez de garder
présent dans votre mémoire » (1917, anonyme). Dans un autre, il faut
donner le sens du mot « tenir », « tenir jusqu’au bout »,
« nos soldats tiendront », « pourvu que les civils
tiennent » et commenter ces paroles (1918). Le sujet a dû être dicté
oralement, puisque l’élève a mal interprété le nom du « dessinateur
Forain », écrivant le « sénateur Forant ». Enfin, en partant de
la métaphore «le sillon est une tranchée », l’élève doit montrer que
« celui qui laboure, sème,
moissonne, sert son pays comme le soldat et contribue à la victoire »
(1918), sujet qui a valu 1/10 à son auteur, malgré le plan fourni avec le
sujet.
Enfin, la septième rédaction (école privée
Schneider) date de 1928 et son occasion est la projection d’un film sur
« Verdun, visions d’histoire » dont l’élève doit sélectionner une
scène marquante (le fort de Douaumont), avant de dire ses impressions
ressenties devant la guerre et « ses horreurs ». Même s’il faut
toujours terminer sur les « sentiments éprouvés à l’égard des
soldats » (l’élève oublie de faire et n’a pas la moyenne), le regard s’est
déporté des témoignages isolés ou d’un imaginaire des combats vers un récit
historique du conflit : de quoi découvrir des « horreurs » en
effet, et donner des arguments au courant pacifiste.
6/ : Le dernier
thème de l’ouvrage est le thème des choses vécues :
Les sujets de rédaction qui touchent au vécu
de l’élève libèrent son esprit. Moins d’interrogation sur ce qu’attend le
maître quant au contenu, l’enfant le maîtrise et même la passion peut
s’installer, au point d’en oublier la forme et la consigne… Ne retrouvons-nous
d’ailleurs pas ce modèle, à l’âge adulte, dans la variété ahurissante des bouts
de papier des parents « portés au maître », avec leur graphie et leur
orthographe souvent sommaires et les explications rocambolesques parfois mais
qui permettent d’appréhender la distance abyssale qui sépare les apprentissages
de l’école institutionnelle et le rendu pratique dans le milieu familial de
certains élèves ? Les causes évoluant nécessairement, le constat reste le
même de nos jours.
Au-delà de la tradition de conservation des
« beaux textes scolaires» aux finalités essentiellement
commémoratives et souvent apologétiques, il existe une vocation spécifique et
irremplaçable du Musée de la Maison d’Ecole
à Montceau-les-Mines qui vise à se donner pour étude le vécu social ou
scolaire à travers les écrits des enfants issus du thème imposé mais rassurant
de la vie quotidienne. A travers lui transparaît le vécu des enseignants et des
élèves dans les enseignements proposés, l’attitude des populations, non envers
l’école, mais envers leur école et, bien sûr, le vécu social au sens large.
Autant de témoignages du passé, qui ramènent
une nouvelle fois à la sauvegarde et à la préservation locales des cahiers et
travaux des élèves et à l’importance aussi du regard qu’on leur porte et de
l’analyse que l’on en fait. Les sujets abordés dans le thème des choses vécues
laissent une place plus importante au « point de vue » des l’élèves
qui parviennent parfois à exceller dans ce domaine de l’expérience personnelle.
Sous le titre
« Choses vécues », nous avons réuni 18 rédactions qui vont de 1902 à
1988. Comme celles de « Choses vues », elles présentent des scènes,
des lieux, des personnages qui font partie de l’environnement des enfants.
Cependant, les textes font ici une place bien plus grande au « point de
vue » personnel de l’écrivain en herbe. Les choses sont parfois
explicitement demandées dans la consigne (« Dites de ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, donnez vos
réflexions personnelles, votre opinion, la raison de vos préférences »),
ou peuvent demeurer implicites. Les récits d’expérience sont autant de brefs
témoignages sur la vie et les mœurs, plus souvent rurales qu’urbaines dans ce
corpus entièrement situé au XXe siècle.
On verra ainsi le jeu
de billes appelé « boulet » à la récréation (1907), le passage du
facteur (1911), des ramoneurs (1917), des bohémiens (1950), la mort du cochon
(1935), l’alambic (1935), la fête du « figot » (1945). On saisira
l’évolution des loisirs en lisant une fillette de huit ans (1902) dont les
distractions préférées sont toutes de plein air : se promener, faire une
ronde, jouer au loup, broder, faire de la dentelle, causer gaiement, lire une
histoire, goûter sur l’herbe, « mais lorsque la pluie tombe et retient à la
maison, on s’y ennuie ». On la comparera à la copie du certificat
(1979) d’un élève qui rit et tremble devant son feuilleton de télévision
préféré (« l’homme qui valait trois milliards »), mais qui peine
ensuite à « retourner à la réalité ».
Même écart entre
Berthe (1910) et Maud (1988) qui doivent envisager leur avenir proche à la
sortie du CM2. Berthe qui a douze ans, précise : « je ne veux pas encore sortir de l’école parce que je veux bien
apprendre à écrire à compter et être très habile pour le métier que je
préférerais » (l’obligation allait jusqu’à treize ans, sauf réussite
au certificat à douze ans). Ce désir de « poursuivre ses études »
pour consolider ses savoirs en écriture et calcul ne vise rien d’autre que
son métier proche. Elle se voit en épicière, métier dont elle a déjà une longue
pratique : « depuis toute
petite, j’ai de tout temps préféré ce métier, car j’aime beaucoup peser les
bonbons, le café, le sucre et de manier les étoffes et de les couper ».
En 1988, Maud qui va entrer en sixième ne semble avoir, en revanche, aucune
image concrète de son avenir, ni proche, ni lointain. Elle va être interne à
Paray-le-Monial, perspective qui ne l’enchante guère (« je vais devoir quitter mes camarades et ma
famille »), mais à laquelle elle se résigne avec réalisme (« Mes parents me disent que ma sœur y
est allée, et que je dois en faire autant, alors je vais y aller »).
Au
fil du temps, évolue aussi le registre d’écriture attendu : jusqu’aux années
1930, on apprend à l’élève à exprimer le sérieux, l’empathie avec les émotions
d’autrui et les « grands sentiments ». Ainsi, dans le sujet mille
fois traité sur « La maison paternelle » (1906), Mélanie décrit une
maison composée d’une cuisine et d’une chambre avec « plusieurs lits bien alignés les uns contre les autres et une armoire où
on met le linge », où dorment au moins sept personnes. Loin d’en rêver
une plus belle et plus grande comme un enfant d’aujourd’hui, elle dit, comme on
l’attend alors, son amour pour cette maison « parce que c’est là que j’ai grandi avec mes frères et sœurs et mes
parents vivront longtemps pour m’entourer de leur affection ».
Germaine (1911), pour qui le facteur apporte aux uns « la consolation, à d’autres la tristesse »,
décrit les pleurs de la mère du marin, toujours sans nouvelle de son fils.
En 1937, en revanche,
il faut décrire la rue principale du village « en essayant de donner un tour amusant à votre description »,
ce que Denise a bien du mal à faire. En 1962, pour le récit du voyage en
autobus, le ton requis est aussi donné : « Faites un petit portrait de chacun [des voyageurs]. C’est si amusant de
prendre l’autobus ! ». Aucune indication de ce genre pour Jean
(1977) : « Vos parents ont
projeté une longue promenade, tout est prêt mais…. », Il doit
inventer les péripéties qui contrarient le projet, sur un mode comique ou
humoristique supposé comme allant de soi. Or, on sait combien ces
« implicites » sont inégalement maîtrisés par les enfants.
Conclusion :
On comprend ainsi
pourquoi la rédaction devenue composition française, puis expression écrite,
enfin production de textes libres ou imposés, a pu cristalliser les polémiques,
puisqu’elle est la vitrine ou la pseudo-vitrine d’un « savoir écrire en
français », sur des formes et des normes complexes, tantôt travaillées en
classe, tantôt acquises de façon bien plus diffuse et dont la banalité sociale
masque la difficulté. Ainsi, un certain humour est omniprésent dans les médias
envahis de comiques professionnels, mais ses règles d’écriture n’en sont
pas plus claires pour des enfants. De même, la rhétorique héroïque ou
pathétique qu’imitaient les élèves des années 1900 sombrait souvent dans le
ridicule ou l’emphase.
Les registres dans
lesquels les élèves parviennent à exceller tout au long du siècle sont ceux qui
permettent de combiner une expérience personnelle (choses vues ou vécues) et
des modèles d’écriture (portés par les lectures, les préparations orales).
Est-ce suffisant pour préparer une scolarisation longue sur le modèle
secondaire ? Nous laissons à d’autres le soin de répondre. La rédaction
est un exercice qui cache plus de compétences qu’il n’en révèle.
Pour clore mon
propos,
j’exprimerai un avis plus personnel, un avis d’enseignant que partagent
certainement les acteurs du musée. On a souvent dit que l’école divise, qu’elle
accentue les différences socioculturelles, loin de les faire disparaître, que
la prise en compte des individus est difficile. Certains disent qu’on n’y
apprend plus rien, d’autres qu’on y travaille trop ! D’aucun pensent que
l’école est un carcan, d’autres qu’elle est l’endroit où s’élabore, si l’on
peut dire, le laxisme contemporain. La rédaction devenue expression écrite,
puis production de textes, libres ou imposés, avant de redevenir à nouveau
rédaction, cristallise les polémiques puisqu’elle est la pseudo-vitrine des apprentissages
de la langue française, cet iceberg qui cache tant de compétences non
exprimées, tant de connaissances qui ne seront jamais finalisées sur ce
support.
Beaucoup de ceux qui parlent de l’école en
mal n’ont jamais mis les pieds dans une école publique ou alors depuis très
longtemps. Ils ne connaissent pas du tout ou peu ce que représente une journée
de classe, une année d’apprentissage d’un enfant… Ils ne connaissent pas plus
les difficultés réelles des enseignants, l’influence de la société sur le
comportement des enfants, l’impact des médias sur la langue écrite et parlée de
ces derniers. Que savent-ils des incessantes répétitions, des réussites, des
enfants en échec de vie qui grâce à l’école entre dans un avenir plus
serein ? Que savent-ils de ce moment miraculeux où la page blanche se
remplit par la main d’un enfant, fusse-t-elle encombrée de fautes et
d’incertitude ? Que savent-ils de l’école dont Georges Jean dans La Passion d’enseigner
disait : « cette école que l’on voudrait tant changer, tant
ouvrir, tant garder »…
L’ouvrage La Rédaction ouvre, vous
l’aurez compris, des perspectives de lecture diverses. Il est le reflet
historique et le témoignage d’époques différentes. A travers les textes se
dégage une émotion particulière accentuée par des reproductions originales de
documents. Des hypothèses sont avancées sur les contenus de l’enseignement de
la rédaction, elles révèlent des indices souvent ignorés qui éclairent les
pratiques pédagogiques. Le lecteur plus avisé pourra retrouver, au fil des
thèmes, les écrits d’un même élève et voir ainsi les progrès de ce dernier sur
le difficile sentier des apprentissages.
Une
étude linguistique se fait jour grâce à l’apport essentiel au groupe de travail
du musée d’Anne Marie CHARTIER, enseignant chercheur au
Service d’Histoire de l’éducation de l’Institut National de la Recherche
Pédagogique.
La Rédaction a été préfacé par Antoine
PROST (historien, l’historien de l’éducation avec un grand H), Professeur
émérite à l’Université de Paris I. Il fut en 1973, membre du premier groupe
de recherche de l’écomusée le Creusot/Montceau et participa à la rédaction de
notre livre Cent ans d’école. C’est
avec lui que j’en terminerai. C’est, en effet, en ces termes qu’il exprime son
sentiment sur l’ouvrage :
« (..) Il est deux usages des musées scolaires. Le premier est nostalgique ;
il cultive l'émotion de retrouver un passé à jamais disparu, que le cours du
temps pare de charmes parfois ignorés des contemporains. (..) Le second usage
du musée scolaire est éducatif : les objets qu'il montre sont traités comme des
messages à déchiffrer, des problèmes à résoudre. (..) L'ouvrage que voici
combine ces deux usages. D'une part, en montrant d'anciennes copies par la
photographie, il nous replonge dans un univers que les plus anciens ont encore
connu, celui des pages écrites à la plume, et des encriers encastrés dans le
pupitre. On voit l'évolution des mises en pages et des écritures et il s'en
faut de peu qu'on ne respire cette imperceptible odeur de craie si caractéristique
des classes. Mais d'autre part, il soumet ces documents à une analyse à la fois
pédagogique et linguistique pour retracer l'évolution de l'enseignement du
Français à l'école primaire. La tâche n'était pas simple et il fallait aux amis
de la Maison d'école de Montceau-les-Mines une certaine audace pour
l'entreprendre et la mener à bien. Ils l'ont fait, je crois, par fidélité
tenace à leur vocation pédagogique et aux traditions de l'école républicaine.
Laisser dormir ces trésors sans les exploiter eût été consternant : plus qu'une
négligence, une sorte d'infidélité, voire de trahison.(..) »
Il me reste, avant de vous laisser la parole,
à exprimer quelques remerciements :
-
à
tous les bénévoles qui ont travaillé sur l’ouvrage
-
aux
professionnels cités qui ont apporté un éclairage essentiel à l’analyse
-
à
la municipalité de Montceau pour son soutien financier et logistique important
et qui ne s’est jamais démenti (nous en avons encore un exemple ce soir, merci
au personnel des services avec lesquels nous entretenons d’excellent rapports)
-
aux
municipalités du Bassin minier (Saint-Vallier, Blanzy, Sanvignes) pour leur
soutien permanent dans nos actions, merci messieurs les élus, nous restons à
votre disposition
-
aux
membres et aux services de l’écomusée
-
merci
aussi à l’imprimeur qui a fait au mieux pour que l’ouvrage soit de qualité,
tout en respectant notre budget
-
et
puis merci à tous les acheteurs de l’ouvrage qui permettront ainsi la parution d’autres
ouvrages.
Merci de m’avoir écouté. »
« La
Rédaction »
Edition luxe
75 rédactions
sélectionnées (36 reproductions photos + 35 transcriptions)
48
illustrations
« La
Rédaction »
Ouvrage en
vente au musée
20euros +
frais de port (2.5 euros)
Commande à
adresser : Musée de la Maison d’Ecole, 37 rue Jean JAURES 71300
Montceau-les-Mines

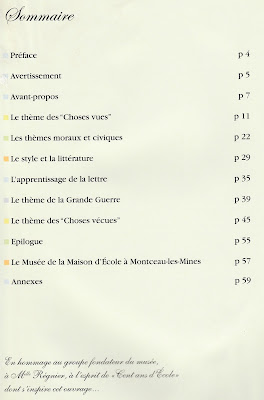



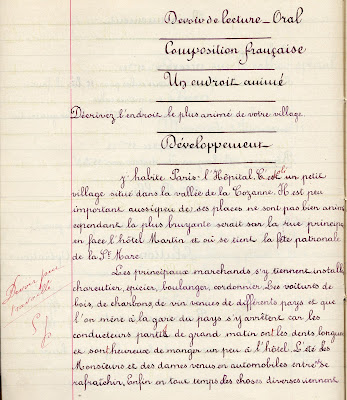



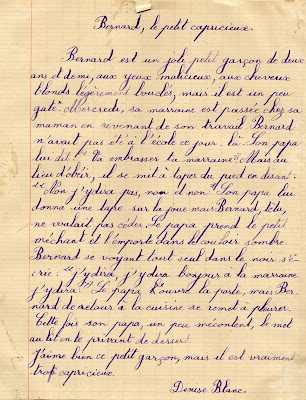

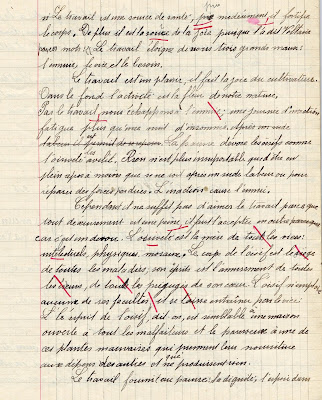










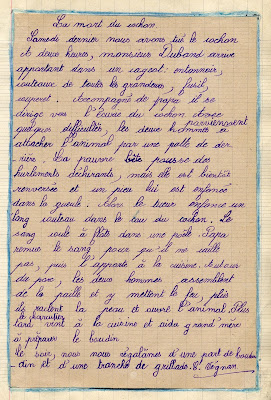
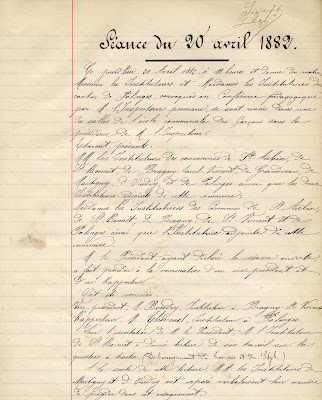
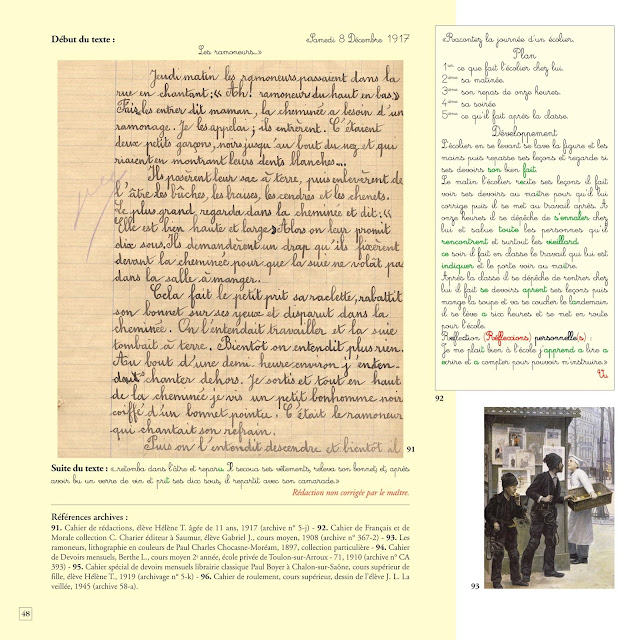

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire