Adieu
Monsieur le Professeur
Pincement
au cœur
Nous y sommes ! C’est la fin de l’année scolaire, la fin des habitudes, le saut vers une autre expérience. Depuis quinze jours déjà, l’atmosphère avait changé dans les classes, plus décontractée, à l’image des vêtements que le retour du soleil avait rendus plus légers. Les réjouissances finales s’annonçaient : spectacles et expositions de fin d’année, ultime voyage scolaire… Une période particulière pour d’autres avec les révisions, les examens, les résultats annonçant un avenir plus ou moins serein. Mais pour élèves et professeurs, c’est maintenant le moment de la séparation, des adieux même, entre ceux qui s’étaient parfois côtoyés pendant plusieurs années. Que d’émotions ! Constat mitigé entre saut dans l’inconnu pour nos élèves et crise des vocations pour nos maîtres…
« Au revoir maîtresse,
vous allez nous manquer ! »
La ruche est vide. Chacun est parti pour un long congé réparateur, mais déjà, les professeurs pensent à la rentrée prochaine où tout recommencera. Si la fin du mois de juin fut le moment de la séparation, début septembre sera celui de la rencontre. Il faudra renouer ces liens qui feront renaître, avec de nouveaux élèves, cette relation de complicité, de confiance et d’autorité, si nécessaire à la transmission du savoir. Un éternel recommencement, chargé des rituels immuables.
« Au revoir maîtresse »
(Le Progrès, 2014)
De
la vocation à l’abandon, le ciel s’assombrit
Que sont devenus ces « apôtres
laïques » de la Troisième République ? D’aucuns
pensent que la trentaine d’années qui sépare les grandes lois organiques de
Jules Ferry de la Grande Guerre, contribuèrent à l’édification de l’école
laïque, en formant de meilleures générations d’institutrices et d’instituteurs,
mieux formés, mieux instruits, et que c’est de là que la corporation a
construit son caractère, ses traditions, ses qualités et ses vertus. Mythe ou
réalité ? Les « Hussards noirs » chers à Péguy sont nés à cette
période. Ces futurs enseignants venaient en nombre des Cours complémentaires et
des Écoles primaires supérieures qui furent des sources abondantes d’un
excellent recrutement populaire. Ce grand nombre de postulants permettait
d’exercer un choix sévère. L’accession au métier était difficile et réservée
aux meilleurs élèves que pouvait produire l’école publique, beaucoup de
candidats mais peu d’élus.
" Aujourd'hui, c'est mon dernier jour
d'école. Dans ma classe - île déserte à cette heure -, je prends la mesure de
l'événement. J'ai vécu des moments de grâce et de doute, des périodes de joie
intense ou de déprime, des minutes d'impatience ou d'angoisse... Je me rappelle
la jeune fille enthousiaste que j'étais... Naïve, pleine d'espoir, je disais:
"Pourquoi pas ?" À présent, je suis lucide et lance : "À quoi
bon ?" J'étais respectueuse des autorités et des traditions de la
"grande maison". Me voici moqueuse, épinglant les uns, brocardant les
autres, pointant les ratages et les incohérences du système éducatif. " En 1990, Nancy Bosson devenait du jour au
lendemain une " star " du monde de l'éducation avec son récit Maîtresse
détresse). Elle avait confié, sur le
plateau d'" Apostrophes ", déjà, le désarroi et le désespoir de
nombre d'instituteurs. À l'heure de quitter son école, elle livrait son
expérience de l'enseignement en maternelle, vécu au quotidien pendant
trente-sept ans…
De nos jours, le nombre des
candidats aux concours de recrutement des enseignants ne cesse de chuter depuis
ces années 1990, tandis que les départs volontaires du métier ne cessent
d’augmenter… Pour cette année 2025, c’est en janvier que le ministère a annoncé,
par académie, la répartition de ces postes qui devait garantir la présence d’un
enseignant dans chaque classe. Les chiffres, compte tenu des contraintes
budgétaires serrées estimées furent naturellement contestés par la base et les
organisations syndicales… Les autorités académiques se heurtent aussi, depuis
des années, au défi récurrent d’attirer suffisamment de candidats au concours,
en pleine crise des vocations. Pour preuve, les concours de recrutement qui
n’en sont plus un, puisque le nombre de postulants ne couvre plus les postes
proposés. Depuis 1989, on note un effondrement de ce nombre des présents
aux épreuves de recrutement externe des enseignements des premier (écoles
maternelles et élémentaires) et second degrés publics (collèges et lycées) :
Source ministère de
l’Education nationale
La situation la plus
critique étant celle du recrutement d’enseignants du secondaire (collèges et
lycées) qui, en moins de trente ans, a chuté des trois quarts, passant de
108 669 en 1997 à 28928 en 2023 concernant les cinq concours en lice
(Capes et Agrégation pour les matières générales ; CAPEPS pour l’éducation
physique ; CAPET pour les établissements techniques ; CAPLP pour les
lycées professionnels).
Alors, quels enseignants
pour nos élèves ? On s’alarme quand on constate, il y a quelque temps, que
des candidats ont été reçus au concours de professeur des écoles avec une
moyenne inférieure à 7/20… ou encore que certaines années, pour la cession du CAPES
de mathématiques, 50 % des postes ne sont pas pourvus, faute de candidats à la
hauteur. François Dubet, sociologue dresse un constat encore plus
radical : « ce ne sont plus les
meilleurs étudiants qui se présentent (..) et en sciences, ce ne sont non
seulement pas les meilleurs, mais ce sont souvent les moins bons ». À
la fin de la décennie 2010, les
inspections académiques, résignées, se sont même tournées vers Pôle emploi, en
vain, un comble. Mais le pire était à venir, avec la dégradation croissante du
service d’éducation. Tous les acteurs de la vie scolaire, y compris les parents
d’élèves, ont pu faire le triste constat que les cours n’étaient plus assurés
partout et tout le temps et que la « réduction des injustices
scolaires » n’était encore qu’un vœu pieu. Le rapport du sénateur Pacaud
de juin 2025 sur le sujet des remplacements est édifiant (https://www.publicsenat.fr/actualites/parlementaire/enseignement-un-rapport-du-senat-souhaite-lutter-contre-le-non-remplacement-des-enseignants).
Pourquoi ce désamour ?
Je ne peux m’empêcher
d’avoir une pensée pour nos prédécesseurs dans le premier degré : les
instituteurs. La plupart étaient passés par les écoles Normales dont on n’avait
de cesse de vanter l’excellence de la formation,
malgré leurs défauts, ainsi que l’excellence des professeurs qui y dispensaient
leur savoir à des promotions de chacune 3 puis 2 ans. Le temps passa et ces Écoles
normales firent place à d’autres formations : IUFM en 1990-91, ESPE en
2013, INSPE en 2019… et maintenant ?
De
nos jours, l'Éducation nationale manque cruellement d'enseignants. À tel point qu'elle a organisé, à partir du mois de juin 2022, des sessions de "jobs
dating" (terme barbare qui correspond à la triste réalité) afin de recruter des professeurs, dans le premier
comme dans le second degré. Cette opération inique a été reconduite depuis
2023…
Nul doute que les normaliens
d’autrefois doivent se retourner dans leur tombe à la vue de ce recrutement
express : ½ heure d’entretien, quelques heures de formation et hop !
Devant les élèves… Quel camouflet pour la profession et pour les usagers du
service d’éducation et quel mépris pour nos professeurs dont on nie par là même,
la réussite à un concours très difficile (niveau bac + 5, Master 2) et dont on fait
fi des compétences acquises durant une longue formation, fondement même du
métier.
École Normale de Mâcon
(collection musée)
Le métier d’enseignant serait-il devenu un métier comme
les autres ?
Sacralisée par la Troisième
République, l’école fut un pilier du modèle républicain. Déjà, Gambetta, avant
Ferry, dressait le cadre de ce modèle
dans son discours de Belleville, en 1869, avant qu’il ne proclame la
république le 4 septembre 1870 : application stricte du suffrage
universel, garantie des libertés individuelles et des libertés publiques
(liberté de réunion, de presse et d’association), la séparation des Églises et
de l’État, instruction primaire gratuite et obligatoire. Ce fils d’épicier
devenu Président du Conseil en 1881 prône alors l’ascension « des couches sociales nouvelles ».
Ce sera l’heure de gloire des enseignants, non pas grâce à la rémunération
relativement faible qui n’entraîna, au demeurant, aucune désaffection pour le
métier, mais plutôt grâce à ces idées républicaines généreuses qui, très vite
promurent un corps enseignant avec ses codes, ses valeurs, ses transmissions,
mais finalement peu ouvert : on a longtemps été enseignant de génération
en génération.
Famille
Grappin en Saône-et-Loire, 6 générations d’instituteurs, 1824-1977 (https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2017/11/une-famille-dinstituteurs.html#more)
De nos jours, ironie du
sort, les enfants de professeurs sont ceux qui souhaitent le moins le devenir… Une
alerte de plus. Le symbolique ne compensant plus le matériel, la dichotomie
entre le niveau d’étude, le salaire et les conditions d’exercice dégradées
éloigne la jeunesse. L’enseignement est devenu une profession comme les autres,
dans une école « désacralisée » et une institution « en déclin »
comme le déclare encore François Dubet. Il est temps, pour la grande Education
Nationale, de comprendre qu’attirer des candidats nécessitera désormais des
conditions de travail et des perspectives de carrières plus satisfaisantes, le
métier étant en concurrence directe avec d’autres plus attractifs. Mode de
recrutement, contenus de formation, tout reste à redéfinir, sachant que l’on ne
rétablira plus la « sanctuarisation » de l’école de Jules Ferry,
même en installant des portiques de sécurité à l’entrée des établissements. Le
prestige de l’instituteur, unique détenteur du savoir, ne reviendra pas. La
mission d’enseigner est désormais partagée avec la famille et la société, le
savoir est partout, tout ne s’apprend plus sur les bancs de l’école. Certains
proposent de recruter des candidats plus jeunes qui, hypothétiquement, seraient
issus, comme autrefois, de couches sociales plus modestes, et seraient bien
contents de gagner plus que le SMIC, bizarre solution qui n’en est pas une.
Quel cynisme !
Normalien de
Mâcon en 1914 (https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2019/08/jacques-ozouf-dans-cent-ans-decole.html#more
)
La fin du sacerdoce laïque
« Dans
cette société de vie longue – l’économiste Jean Fourastié parlait de « la
civilisation des vies complètes » - on a envie d’être jeune, adulte puis
vieux. Une vie longue est une vie de discontinuité, où l’on peut retenter sa
chance en permanence » Jean Viard, Le Monde, 24 juin 2015
Dernier écueil, la
« discontinuité », notion exprimée par le sociologue Jean
Viard : qui, dans la jeunesse actuelle, rêve de s’engager dans un emploi
pendant 45 ans, avec un monotone déroulement de carrière tout tracé ? La
rentrée 2024 avait mis en lumière une pénurie d’enseignants sans précédent en
France avec plus de 3 000 postes vacants. Les valeurs d’altruisme et
d’utilité sociale de nos maîtres d’autrefois ne feraient-elles plus
recette ? Les maux sont identifiés ou presque : faible rémunération,
affectation géographique subie, choix du niveau de classe imposé, médiatisation
effrénée des difficultés du métier, développement sans fin de « tâches
managériales », des fiches à remplir, des tableaux à renseigner, des
comptes à rendre qui détournent les enseignants de leur rôle humaniste de
pédagogue…
Des questions en suspens
auxquelles il faudra bien répondre si l’on veut que la nouvelle génération
d’étudiants qui arrive sur le marché du travail, en quête de sens, ressente la
vocation pour ce que l’on a appelé « le plus beau métier du monde ».
Clin d’œil de consolation
Au final et malgré tout, les
enfants seront toujours que des enfants, aujourd’hui comme hier… Une motivation pour les vocations.
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo
bonnes vacances et à la rentrée !
Patrick
PLUCHOT

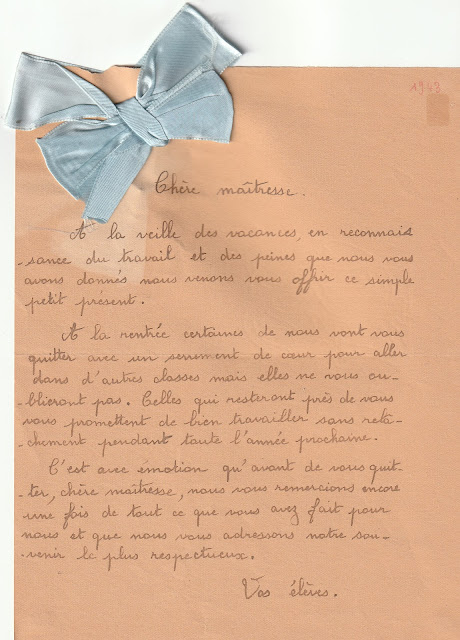







Bonjour Monsieur PLUCHOT,
RépondreSupprimerC'est vraiment ce climat dans les écoles où nous sommes DDEN.
Ce sentiment d'appartenance à un groupe existe toujours entre élèves et profs!!
Merci pour toutes vos publications.
Cordialement.
Jean-Bernard Douteau
Musée départemental de l'école publique de Chte mme
17330 VERGNÉ
*****
Vive les vacances
RépondreSupprimerA bas les pénitences
Les cahiers au feu
Et les vieux au milieu
( chanson des écoliers de l’école de la rue de l’Est)
Bonjour,
RépondreSupprimerEn 2007, en binôme avec une collègue, voici les derniers mots échangés avec les élèves de ma dernière promotion de terminale Bac-pro..
Je cite ; "Au revoir papa, au revoir maman. Au revoir les filles, soyez prudentes.".
Je n'oublie pas.