Journée
pour les droits des femmes 2025
Être Normalienne en 1920
École
Normale de Mâcon
Yvonne à l’École Normale de
filles de Mâcon en 1920 (collection musée)
Être
Normalienne en 1920, entre sacerdoce et carcan ?
L’imposante
grille de l’École Normale de filles de la rue de Flacé s’est refermée sur elles.
Ceinte de hauts murs, l’École va séparer, de la rue, de la ville, de la
famille, de la vie sociale, les heureuses élues de la promotion 1920-1923, pour
un temps… Désormais, ces dernières vont intégrer le microcosme créé à
l’intérieur de ces murs : « le séminaire laïque » comme le
décrira Maurice Gontard. Tout sera modèle durant ces trois années. La rigueur
va s’imposer, dans les cours des professeurs, dans l’école annexe où elles
s’entraineront à respecter les canons de la leçon modèle, à l’internat enfin,
où se forgeront les bonnes habitudes et ce maintien ferme et réservé qui, mieux
que l’austère tenue vestimentaire, désignera « l’Institutrice »
qu’elles deviendront. La figure tutélaire de la Directrice de l’École Normale,
modèle parmi les modèles, y veillera… Une éducation à l’image de la société de
l’époque.
RAPPEL
Suite de l’article
École Normale de Mâcon, 1920
(collection musée)
Il aura fallu près d’un
siècle pour que chaque département possède une École Normale d’instituteurs et
une École Normale d’institutrices. À l’orée des futures lois scolaires de Jules
Ferry, c’est Paul Bert qui en sera l’artisan final avec sa loi du 9 août 1879 :
« tout département devra être pourvu
d’une École Normale d’instituteurs et d’une École Normale d’institutrices,
suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses
institutrices communales. Ces établissements devront être installés dans un
laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la loi. » La loi
prévoie aussi d’annexer à chaque École Normale, une école primaire dans
laquelle les normaliennes et les normaliens s’exerceront à la pratique de
l’enseignement. Au surplus, une école maternelle devra être annexée aux Écoles
Normales d’institutrices.
Nul doute que la victoire
des républicains aux élections de 1878 et la naissance de la toute jeune
Troisième République ne sont pas étrangères à cette loi. Le contexte national
est difficile et il convient d’imposer une nouvelle école, républicaine
celle-là, dans un pays à l’emprise religieuse considérable, et au sentiment
national d’avoir été humilié par la défaite de 1870 et la perte d’une partie de
son territoire. Quoi qu’il en soi, en ce qui concerne le département de
Saône-et-Loire, deux écoles normales avaient été créées bien avant : en
1833 pour les instituteurs et 1842 pour les institutrices (1).
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
Rentrée
à l’E.N d’institutrices de Mâcon en 1920
Le premier jour de la
rentrée, les nouvelles normaliennes durent présenter le trousseau dont la liste
leur avait été imposée lors de l’inscription. Outre les vêtements, il était
demandé aux élèves-maîtresses de fournir draps, couvertures, affaires de
toilette et toutes autres choses nécessaires à la vie quotidienne. À cet égard,
on retrouve, dans les fonds d’archives départementales, des dossiers d’aide au
financement de ces trousseaux pour les familles modestes qui ne pouvaient pas
assumer cette obligation.
Malgré les assouplissements
préconisés par les instructions de 1920, les restrictions qui accompagnaient la
liste étaient toujours rigoureuses, pour exemple : « douze paires de bas pas trop transparents, un chapeau
noir de forme simple, sans plumes ni fleurs, du savon blanc de Marseille
(il est interdit d’apporter
des savons parfumés, des flacons
d’odeur, de la poudre, etc) ». La situation avait malgré tout évolué
et l’austérité vestimentaire s’était adoucie quelque peu tout en restant
sévère. On toléra quelques fantaisies qui ne manquèrent pas d’être moquées lors
des promenades « encadrées » et en rang dans les rues de la
ville : « Les « pies »
c’étaient les normaliennes. Elles devaient ce surnom à l’aile blanche qui, sur
leur chapeau noir, égayait leur « robe de costume » entièrement
noire. »
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1918-1921 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, tenue de travail : robe longue, tablier et bas
noirs, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1925 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, en « robe de costume », promotion
1918-1921(collection musée)
Sur le plan de la formation,
les candidates au concours de l’École Normale devaient être munies du Brevet
élémentaire que nombre d’entre-elles avaient obtenu dans les Cours
complémentaires ou les Écoles primaires supérieures. Depuis l’arrêté du 4 août
1905, les deux premières années d’études relevaient de la culture générale que
devaient acquérir les institutrices et les instituteurs, années à l’issue
desquelles ils seraient soumis à l’examen du Brevet supérieur. La troisième
année, quant à elle, était consacrée essentiellement à la pédagogie de terrain,
année à la fin de laquelle le Certificat de fin d’études normales les attendait, avec deux épreuves : une épreuve
orale, la présentation d’un mémoire sur un sujet de pédagogie, et une épreuve
pratique, une leçon modèle présentée à l’École annexe. Le C.F.E.N ouvrait la
porte à la stagiairisation, pour être définitivement titularisé dans un poste,
il fallait encore, lors du premier trimestre de la nomination, réussir l’épreuve
du Certificat d’aptitude pédagogique
(C.A.P) (2). On voit bien alors l’utilité et l’importance de ces
classes « annexées » aux Écoles Normales au sein desquelles les
normaliennes avaient déjà fait leurs premières armes durant leur troisième
année.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, cour de l’École annexe, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, cour de l’École annexe, 1925 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, élèves de l’École annexe, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, élèves de l’École annexe, 1925 (collection musée)
D’aucuns pensent que la
trentaine d’année qui sépare les grandes lois organiques de Jules Ferry de la
Grande Guerre contribuèrent à l’édification de l’école laïque, en formant de
meilleures générations d’institutrices et d’instituteurs, mieux formés, mieux
instruits, et que c’est de là que la corporation a construit son caractère, ses
traditions, ses qualités et ses vertus. Mythe ou réalité ? Les
« Hussards noirs » chers à Péguy sont nés à cette période, toutefois,
on oublie un peu trop les Hussardes ! Comme noté précédemment, ces futurs
enseignants venaient en nombre des Cours complémentaires et des Écoles
primaires supérieures qui furent des sources abondantes d’un excellent
recrutement populaire. Ce grand nombre de postulants permettait d’exercer un
choix sévère.
Retour
en arrière sur l’École Normale d’Institutrices de Mâcon dans les années 1920
Si en 1842, la
Saône-et-Loire possède un « cours normal », en 1848, il n’y a alors
que huit Écoles Normales d’institutrices en France, ainsi qu’une trentaine de
« cours normaux » dans lesquelles on assure une petite formation,
avant tout morale et religieuse, pour les futures institutrices d’école
publiques. En 1920, les conditions de vie dans les Écoles Normales sont
toujours difficiles et la discipline y est sévère. Ferdinand Buisson
n’utilise-t-il pas lui-même l’expression de « couvent laïque » ?
L’isolement que procurent les lieux, outre les savoirs et les connaissances,
imprègne les futures institutrices de leur devoir de « servir
l’État ».
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
On n’hésite pas à orienter
la vie privée qui sera la leur à la sortie. Comme l’ont exprimé Jacques et Mona
Ozouf dans leurs ouvrages, le repli sur soi est théorisé : « Il faut être bien avec tout le monde
mais très bien avec personne », en évitant les marques de sympathie
qui pourraient être interprétées comme du favoritisme ou de la corruption et
nuire à la réputation de la fonction. On va jusqu’à les mettre en garde contre
les demandes en mariage de certains hommes « qui
seraient appâtés par le salaire et qui voudraient à tout prix devenir des
« maris d’institutrices »…
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
L’administration préconise
les mariages « républicains » entre les institutrices et les instituteurs.
Dès 1880, de nombreux ouvrages de morale circulent dans les Écoles Normales.
Les prescriptions y sont nombreuses. On conseille aux institutrices, par exemple,
de « rester célibataire au moins
trois ans pour reconnaître les bienfaits de l’État et faire son service le
mieux possible sans charges d’intérieur pour le ménage ou rechercher si possible le compagnon avec lequel on pourra lire le
même livre.» Jacques et Mona Ozouf, La République des Instituteurs.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
La garante de cette
discipline de fer est Madame la Directrice de l’École Normale, elle-même
soumise à un contrôle permanent des autorités académiques. Un rapport est
rédigé chaque mois sur les événements qui se sont produits dans
l’établissement.
Exemple de rapport mensuel
rédigé à la suite d’une visite d’École Normale (Douai), 1900 (AD du Nord)
Les visites officielles se
succèdent, Monsieur l’Inspecteur général et Monsieur le directeur départemental
viennent assister à plusieurs leçons dans plusieurs classes. Leurs rapports
précisent le nombre d’élèves, la situation générale, les inspections du
personnel, la tenue du Conseil d’administration, les études et, bien sûr, la
discipline.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
Madame la Directrice avait
ses appartements dans l’établissement. On imagine, au regard de ces derniers, la
place importante que la charge occupait dans la hiérarchie académique.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
Un
formatage en règle
La rigueur et la droiture
était de mise au sein du personnel qui logeait lui aussi au sein de
l’établissement. On comprend, en voyant la photographie de ces dames, que les
normaliennes n’avaient aucune envie d’être convoquées pour une quelconque
faute…
École Normale
d’institutrices de Mâcon, Mlle Curet, au centre, Directrice, 1920 (collection
musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, toujours Mlle Curet, au centre, Directrice, 1925
(collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)
Une discipline féroce
s’appliquait aux normaliennes qui, pour certaines, avaient du mal à se plier
aux règles, comme en témoigne aux archives départementales, certaines lettres
de démission. Les « mœurs légères » sont fermement condamnées, le
travail est constamment évalué, les élèves sont comparées entre elles, un
classement est effectué chaque mois et il en va de même entre les promotions.
Les élèves en difficulté sont pointées du doigt et le Conseil des professeurs
n’hésite pas donner « un
avertissement d’avoir à mieux travailler pendant le dernier trimestre, sous
peine d’exclusion en fin d’année ». Les graves manquements sont
sanctionnés par des punitions collectives ou individuelles, annoncées
publiquement devant les promotions réunies. Les lectures des normaliennes sont
censurées. La vie en collectivité est monacale et les journées d’études fort
longues.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, 1920-1925 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, le « petit théâtre » pour les rares fêtes
et représentations classiques, 1920 (collection musée)
Si les études à l’École
Normale sont ardues, on n’apprend pas à ces futures institutrices à gérer les
situations difficiles qu’elles seront amenées à rencontrer dans leurs premiers
postes. Alors, une forme de solidarité apparaît à la fin du 19e
siècle, à travers les amicales et les embryons de syndicats. Certains auteurs
abordent le sujet et publient des conseils sur les actions qu’elles auront à
faire au quotidien. Ces ouvrages seront beaucoup lus des normaliennes, prémices
du Code Soleil (3). On citera l’ouvrage de Jules Payot « Avant d’entrer dans la vie : aux instituteurs et aux
institutrices, conseils et directions pratiques, 1897. Il incite les
futures nommées à se renseigner sur les postes à prendre, à se méfier des faux
renseignements. Il leur conseille de commencer dans des écoles mixtes, sans
collègues instituteurs plus âgés qui pourraient influer sur leur jugement. Il
leur parle de leur appartenance au corps des enseignants et du fait de toujours
soutenir leurs collègues sans les critiquer.
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 1ère année, 1920
(collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 2e année, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 3e année, 1920 (collection musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1922-1925 (collection
musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1923-1926 (collection
musée)
École Normale
d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1924-1927 (collection
musée)
Vers
une émancipation lente mais nécessaire
À une époque où la femme
reste socialement soumise au dictat masculin, normaliennes et institutrices
sont étroitement contrôlées par l’Institution scolaire qui leur rappellera,
durant toute leur carrière, leur statut de représentante de l’école
républicaine. Dès l’entrée à l’École Normale, les futures institutrices qui s’opposent
à l’Institution sont systématiquement écartées de la formation. Les mœurs
« trop légères » sont de la même manière sanctionnées sans beaucoup
de discernement (4).
Détail de rapports mensuels
rédigés à la suite d’une visite d’École Normale (Douai), 1900-1902 (AD du Nord)
On peut s’interroger sur la
frontière entre la vie privée et la vie publique de l’institutrice, mais y en
a-t-il vraiment une ? En 1920, certes pas. Elle est toujours en
représentation, dans sa vie, dans ses loisirs, dans ses choix, elle est, comme
nous l’avons dit, la représentante de l’École publique, de l’École de la
République. Le combat engagé par les grandes figures de l’émancipation féminine
n’a pas encore porté ses fruits…
En ce mois de mars qui a vu
le 8 la Journée internationale pour le droit des femmes, il n’est pas inutile de
rappeler la mémoire de deux institutrices qui menèrent ce combat.
Louise
Michel (1830-1905), institutrice républicaine. souvent dénoncée
par ses détracteurs, elle resta fidèle à sa ligne de conduite malgré les
pressions, elle écrira : « J’allai
chez le Recteur de l’académie (..) je m’expliquai au sujet des dénonciations
envoyées à mon égard, disant que tout était vrai, que je désirais aller à
Paris, que j’étais républicaine (..) Mais, malgré les dénonciations de quelques
imbéciles sur mes opinions politiques, ma classe marchait d’autant mieux que
j’avais le zèle de la première jeunesse ; je la faisais avec passion.
(..). À ma classe d’Audeloncourt on chantait la Marseillaise avant l’étude du
matin et après l’étude du soir. » Elle paiera cher la défense de ses
idées.
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo
Marie
Guillot (1880-1934), institutrice de Saône-et-Loire dont l’histoire
nous sera rappelée lors de la conférence du 29 mars, organisée par le Musée de
la Maison d’École.
Conclusion
La
fin du 19e et le début du 20e siècle sont des époques
charnières dans le domaine de l’éducation des filles. L’émancipation des femmes
est en marche et les institutrices sont les témoins privilégiés des changements
dans la société. Elles portent cette évolution et en sont les actrices. Même si
leurs conditions restent difficiles, elles jouent un rôle déterminant dans la
réévaluation de la condition et du statut des femmes. Leur désir de s’investir
dans la vie sociale et même politique est fort, elles deviennent alors des militantes :
« Le féminisme et la
laïcité sont deux thèmes particulièrement représentatifs qui marquent un réel
progrès dans la vie sociale des femmes de l’époque. La démarche d’émancipation
des femmes n’a pas cessé depuis le XIXe siècle, les femmes ont petit à petit su
obtenir de nouveaux droits et plus de libertés : droit à l’éducation et à la
formation, droit civil, exclusivité dans l’appartenance de son propre corps
avec le droit à la contraception et celui sur l’avortement, et cela jusqu’à l’«
ultime droit » celui de voter. Tout cela n’a été possible que grâce à
l’investissement personnel et à l’implication de femmes et d’hommes, des
personnalités politiques mais également des personnes investies dans la vie
quotidienne telles que les institutrices. » Jacques et Mona OZOUF, La République des instituteurs, Hautes
Études, Gallimard,
Le Seuil, Paris, 1992.
Patrick PLUCHOT
(1) :
revoir à ce sujet les articles du blog Aperçu
historique sur l’École Normale d’institutrices de Mâcon : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2023/04/apercu-historique-de-lecole-normale.html#more et Aperçu historique de l’École Normale
d’instituteurs de Saône-et-Loire : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2023/10/lecole-normale-dinstituteurs-de-macon.html
(2) : Quelques
précisions sur la formation :
Une
partie des futur(e)s instituteurs (trices) furent recrutés(es) sur concours dès
1879. Les candidats devaient posséder le certificat d’études primaires (CEP) voire par la suite
le brevet d’enseignement primaire élémentaire (brevet élémentaire –
BE). Les candidats venaient majoritairement des cours complémentaires (cursus dit "populaire") ou
des écoles primaires supérieures
(EPS) ou des collèges et lycées (cursus dit "bourgeois").
Jusqu’en 1940, et après trois années de formation, les admis au concours devaient
réussir le brevet de capacité pour
l’enseignement primaire - correspondant au brevet supérieur (BEPS) - leur
donnant le droit d’être nommés instituteurs-stagiaires et d’obtenir le certificat d’aptitude pédagogique (CAP) dans
leur première année de nomination.
Supprimées
par le Régime de Vichy, les écoles normales sont rétablies en 1945. Le
recrutement s’adresse prioritairement aux élèves de troisième des cours
complémentaires du cursus dit "populaire". La formation dure quatre
ans incluant la préparation du baccalauréat dans les écoles normales. La 4e
année est sanctionnée par le certificat
de fin d’études normales (CFEN) permettant d’être nommé
instituteur-stagiaire. À la fin de leur 1er trimestre d’enseignement et
après une inspection, les instituteurs-trices doivent être admis au certificat d’aptitude pédagogique (CAP) pour
être titularisés.
À la
rentrée 1990, les écoles normales sont à cette date remplacées par les
Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) puis par les Écoles
supérieures de professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) à la rentrée 2013-2014 et
deviennent à la rentrée 2019, Instituts nationaux supérieurs du professorat et
de l’Éducation (INSPÉ) à la suite de la promulgation de la loi n° 2019-791 du
26/07/2019 "Pour une école de confiance", composante universitaire
rattachée à un établissement – université ou communauté d’universités.
(3) : revoir
à ce sujet les articles du blog : Le
Code Soleil : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2024/04/le-code-soleil.html#more
(4) : Voici
deux exemples de sanctions prises à l’encontre de normaliennes présentant de
« graves dangers » à l’École Normale de Douai, les unes ayant quitté
le dortoir à plusieurs reprises pour « d’obscures raisons » et une
autre ayant entretenu une relation épistolaire interdite avec un jeune homme et
ayant caché un « écrit pornographique ».

















































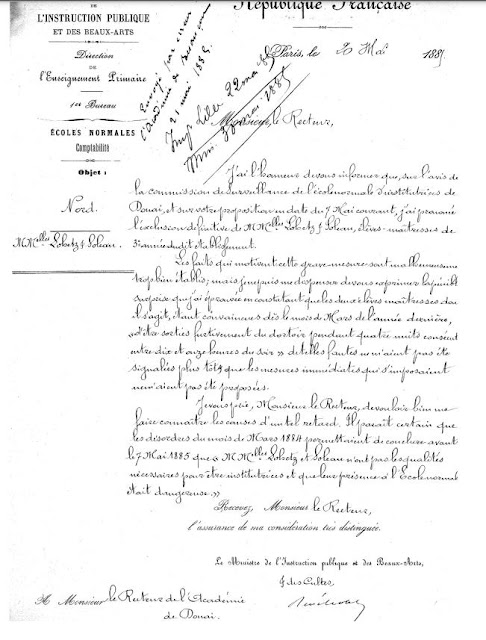

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire